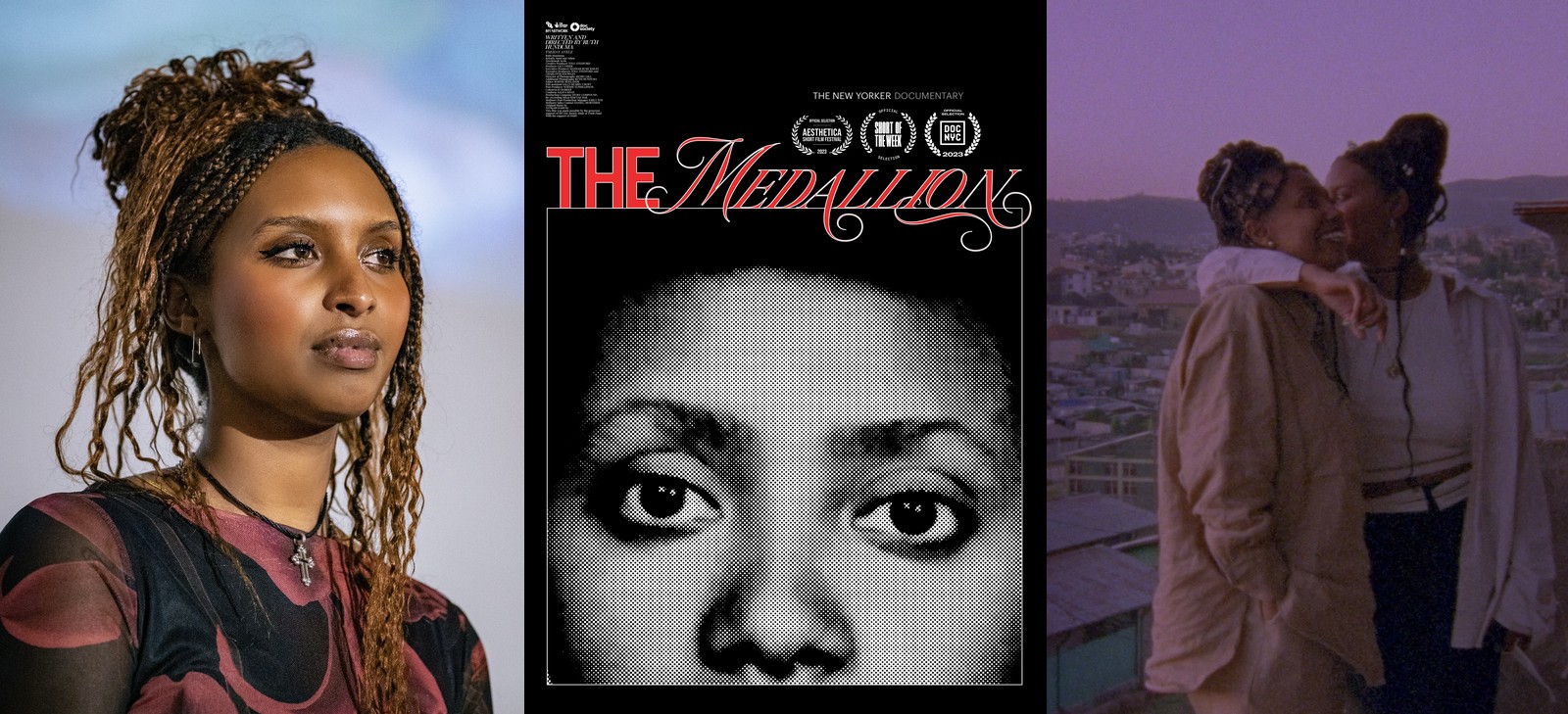Laura, Israël et leur fils Lucas vivent ensemble mais ont comme perdu tout intérêt les uns pour les autres. Alors que leurs relations semblent sur le point de dérailler, Laura a la prémonition d’une catastrophe imminente.

Desterro
Brésil, 2020
De Maria Clara Escobar
Durée : 2h07
Sortie : –
Note : ![]()
JE M’EXILE, SI FRAGILE
Desterro débute par un mouvement de caméra aussi élégant que menaçant, survolant les toits puis descendant vers le jardin des protagonistes, se resserrant sur eux juste quand une averse leur tombe dessus. Au moment où l’on s’attendrait à ce qu’ils se précipitent à l’abri, ils ont comme une hésitation flottante. Qu’est-ce qui les freine à regagner le logis ? L’expression « famille nucléaire » est connue, mais peut-on retourner la métaphore pour décrire des familles où, à l’inverse, chaque membre serait comme un atome indépendant ? Laura, Israël et leur fils ont moins l’air de former un foyer que de cohabiter dans l’indifférence. Lorsqu’ils se parlent, la caméra s’attarde d’ailleurs moins sur eux que sur les objets du quotidiens (un geste qui rappelle le Haneke des débuts).
Les premières scènes de Desterro n’y vont pas avec le dos de la cuillère vers la radicalité (personnages absents du cadre ou alors filmés de dos, aridité des dialogues). Pourtant, dès cette très sévère introduction, un mystère plane. Il y a quelque chose de fantomatique qui nait des décalages récurrents entre le son et l’image, comme lorsque la radio – que personne n’écoute vraiment – diffuse des nouvelles d’une catastrophe tandis que l’on coupe un gâteau d’anniversaire. Aucun des protagonistes n’y prête attention car ils sont comme ailleurs, à commencer par Laura qui, quand on lui demande si elle est là, répond « Je crois bien que oui ». Cette menace fantôme qui pèse sur elle va peu à peu contaminer tout le film.
On a déjà croisé ce magnétisme spectral et minimal entourant des personnages comme absents à leur propre vie, notamment du coté de la formidable École de Berlin. Mais on n’a jamais vu le curieux mélange à l’œuvre dans Desterro, film qui a certes un pied ancré dans cette radicalité, mais l’autre baignant dans une chatoyante composition visuelle, un charme esthétique généreux tel qu’on le retrouve dans le meilleur du cinéma brésilien contemporain. Les couleurs sont d’autant plus vives qu’elles viennent en rupture avec de profonds silences, les variations lumineuses sont d’autant plus émouvantes qu’elles semblent indiquer qu’un nuage se tient toujours prêt à venir assombrir n’importe quelle scène quotidienne.
Pour son premier film de fiction, la documentariste et poétesse brésilienne Maria Clara Escobar (lire notre entretien) jongle avec bonheur entre les contrastes et les ruptures de ton. Une question de mise en scène (quelles compositions !) mais aussi d’écriture: le récit fait des pauses, des retours en arrière, se métamorphose pour tendre vers le fantastique, jusqu’à ce que le quotidien de Laura prenne des dimensions inattendues, rappelant ainsi un autre sommet cinématographique récent : I Was at Home, But…, avec qui Desterro partage plus d’une fulgurance.
Également directrice de casting, la réalisatrice Maria Clara Escobar réunit en effet autour de Carla Kinzo une sorte de dream team des actrices les plus charismatiques du nouveau cinéma brésilien : Isabél Zuaa (Les Bonnes manières), Bárbara Colen (Bacurau), Grace Passô (Temporada, Au cœur du monde) ou encore Julia Katharine (I Remember the Crows). Comme chez Angela Schanelec, l’héroïne de Desterro (qui signifie Exil) est « chez elle, mais… ». Elle est surtout déjà ailleurs, sur une route imprévisible, comme toutes les femmes autour d’elles. Un voyage fascinant.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |
par Gregory Coutaut