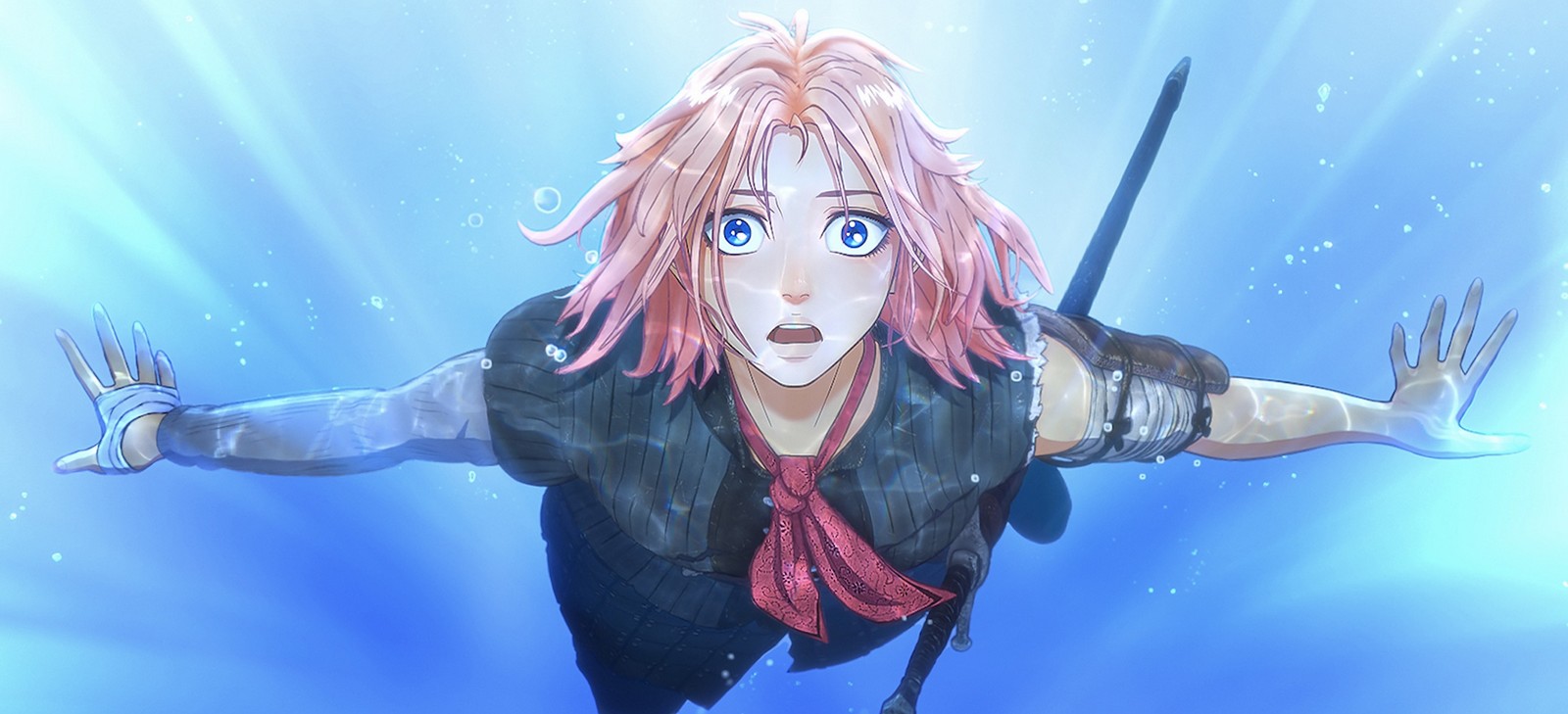Le réalisateur malien Ousmane Samassékou a été couronné l’an passé au Festival CPH:DOX avec son film Le Dernier refuge. C’est un documentaire poignant sur les utopies, la mélancolie, la résignation ou le courage de migrant.e.s dans une maison au bord du Sahel qui les accueille, dans un sens ou l’autre de leur périple. Ousmane Samassékou nous en dit davantage sur ce film sélectionné cette semaine au Festival Cinéma du Réel.
Quel a été le point de départ du Dernier refuge ?
Depuis mes débuts au cinéma, j’ai toujours eu envie de faire un film sur la thématique de l’immigration mais je voulais quelque chose d’authentique, de différent, avec une force dramaturgique et cinématographique. En 2018, lors d’un atelier organisé par Steps avec Don et Tiny, je découvre la maison du migrant qui se trouve au nord de mon Mali et dont je n’avais aucune connaissance en tant que Malien. C’est alors que l’envie d’aller découvrir cet endroit m’est venue. Avec le soutien dès le départ de mes producteurs Estelle Robin et Andrey Samoute Diarra, ainsi qu’avec l’aide au développement de Steps, je voyage ainsi sur Gao pour un repérage filmé.

Comment avez-vous créé ce sentiment d’intimité que l’on ressent dans votre film ? Comment avez-vous trouvé votre place et la bonne distance pour vous entretenir avec les différents intervenants du Dernier refuge ?
Ce sentiment d’intimité a été initié et développé tout le long du film en grande partie par le sens d’attente, d’observation et d’écoute mais aussi de partage. Les migrants sont des personnes fragiles qui ont été longtemps montrés sauvagement par les médias. Il fallait pouvoir leur faire comprendre que ce film est là pour leur donner une forme d’humanité, montrer leurs rêves, leurs vies d’avant le naufrage, leurs peines mais aussi leurs espoirs tout en gardant leur dignité.
Le repérage m’a permis de me fondre dans le décor et la masse afin de me trouver une place comme si je faisais partie d’eux. Comme si j’étais un migrant comme eux. Quand on arrive dans un endroit précaire, et qu’on arrive à s’adapter à la vie des gens, à manger avec eux, à boire avec eux, même à dormir dans les mêmes conditions. Au fil du temps, ils vous acceptent et oublie même que vous détenez une caméra. Mais il est essentiel de leur expliquer le film, le pourquoi et le comment.

Comment avez-vous abordé la mise en scène du désert, dont les images impressionnantes reviennent régulièrement dans votre film ?
Je cherchais quelque chose de plus cinématographique. Comment faire ce voyage dans ce lieu sans être avec un personnage. Être avec la poésie, la violence, l’aridité et le calme dans cet espace qui porte des rêves et brise des vies. Je suis content que la production ait soutenu l’idée. Cela a rendu le film plus dramatique.

Qui sont vos cinéastes de prédilection et/ou qui vous inspirent ?
En documentaire, j’adore le travail de Rithy Pan : sa façon très imagée de reconstituer le passé mais aussi de le raconter est très inspirant et créatif. Ensuite Peter Krüger, qui utilise la nature, les animaux dans ses œuvres et travaille beaucoup sur la poésie de l’image et de l’espace dans ses films. Il peut jouer avec différents personnages, lieux et histoires mais tout en gardant une forte dramaturgie. Il travaille beaucoup l’imaginaire et les métaphores.
Il y a Yann Arthus-Bertrand, qui part des petites choses de la vie, des histoires anodines aux plus effroyables. J’adore sa manière décousue de nous présenter des témoignages… Et il y a aussi Alice Diop dont le film Vers la tendresse m’a un peu inspiré sur comment raconter un témoignage sans forcément être avec le personnage et surtout voyager à travers ce qu’il nous raconte avec l’image.
Pour la fiction, j’adore les films de Djibril Diop Mambety qui ressemblent le plus souvent à du documentaire. Il utilise beaucoup d’allégresse avec les ambiances réelles d’une rue, d’un marché sans aucune mise en scène, il capte le réel pour l’amener dans la fiction. Le jeu est tellement naturel qu’on penserait qu’il est parfois dans du cinéma direct, du réel et non dans de la fiction. Il utilise la poésie et la métaphore qui nous font voyager dans un imaginaire profond, quand il fait jouer par exemple une scène de western en plein ville…

Quelle est la dernière fois où vous avez eu l’impression de voir quelque chose de neuf, de découvrir un nouveau talent ?
Je pense que l’imaginaire ne finit jamais et chaque film apporte du neuf à sa façon, mais aussi que chaque film est inspiré en partie par un autre même si le fond peut changer.
Avec le film de Maimouna Doucoure, Maman(s), en 2017 je crois, je trouve que la thématique de la polygamie en Europe n’avait pas encore été traitée de la sorte et cela à donne une grande force au film. Il y a aussi Félicité d’Alain Gomis, qui est un film sur le rêve, je suis toujours captivé par la façon dont on filme le rêve ou comment on l’aménage dans un film. Je citerais également Bakary Diallo, un jeune cinéaste malien décédé lors d’un crash. Il pouvait faire tout un film sans parole et on comprenait le tout. Il m’a appris à donné du souffle, à laisser du temps mort, le silence et de la respiration.
Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 3 mai 2021. Un grand merci à Mirjam Wiekenkamp.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |