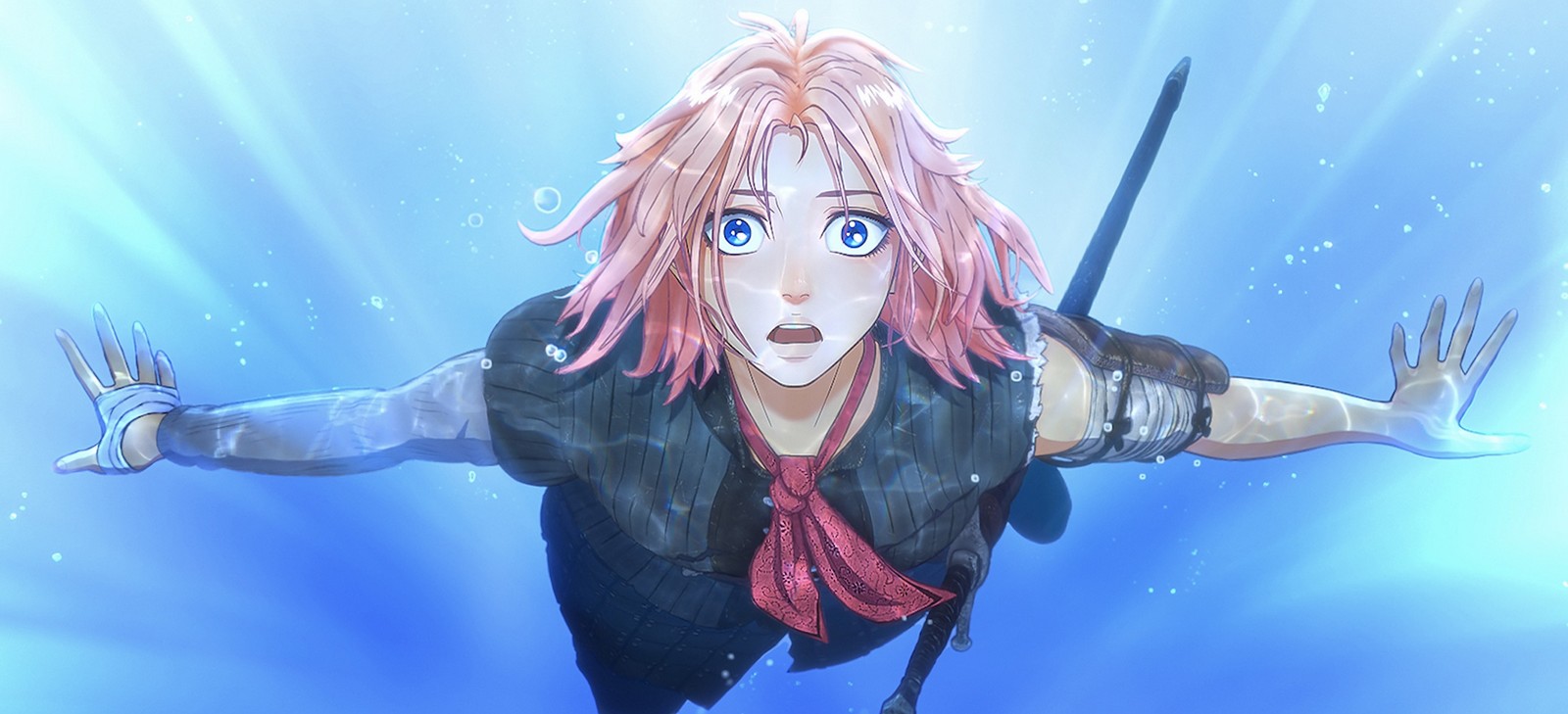Présenté par Dario Argento et lauréat du prix du meilleur premier film à Locarno, She Will est un superbe conte fantastique en forme de métaphore sur le cinéma. Ce long métrage sort ce mercredi 30 novembre en salles. Venue de l’art contemporain, la réalisatrice britannique Charlotte Colbert (qui figure dans notre dossier consacré aux révélations de l’année) est notre invitée de ce Lundi Découverte.
Avant de parler de She Will, je voulais vous parler d’une œuvre video que vous aviez réalisée précédemment : Benefit Supervisor Sleeping, d’après la peinture homonyme de Lucian Freud. Y a-t-il selon vous un parallèle à faire entre la manière dont ces deux œuvres déplacent le status duo du regard masculin ?
C’est vrai qu’il y a des reflets dans les thèmes abordés dans les deux cas. Benefit Supervisor Sleeping était à l’origine un portrait de Sue Telly qui était la muse de Lucian Freud et c’est l’un de ses tableaux à s’être vendus le plus cher. Il s’agit d’un nu d’elle alors qu’elle a les yeux fermés, et j’y vois une sorte d’emprisonnement de sa personnalité pour toujours. Le portrait d’elle que j’ai effectué à mon tour renverse cela car il s’agit d’un portrait vidéo filmé où elle ouvre progressivement les yeux. Elle possède un corps qui n’est pas standardisé par les esthétiques contemporaines de beauté. Les spectateurs la regardent, ils s’approprient son corps et ils se retrouvent soudain face au moment où elle ouvre les yeux pour les regarder.
C’est toujours amusant de voir ce moment où les spectateurs se redressent et corrigent leur propre regard car il réalisent qu’ils sont observés aussi. Cette œuvre était une collaboration avec Sue, et cette question du regard l’intéressait beaucoup, et c’est vrai que c’est un questionnement qui se poursuit dans She Will.

Les personnages de She Will semblent d’abord appartenir à des archétypes féminins mais le scénario vient les enrichir d’un décalage qui fait que là encore, notre regard est déplacé. Comment avez-vous travaillé cette question-là ?
Nous avons coécrit le scénario avec Kitty Percy. La question d’une relation similaire à celle d’une mère et d’une fille était très présente dès le début de l’écriture. Par la suite, nous avons appris que les deux dernières femmes à avoir été condamnées pour sorcellerie dans l’endroit où nous avons tourné avaient elles-mêmes le même types de rapports. C’était très bizarre d’apprendre cela, c’est comme si une sorte de transfert s’était operé de lui-même pendant le tournage. Le parti pris du film était de se baser sur des archétypes et des figures-clé du cinéma d’horreur (les sorcières, le manoir, l’Ecosse, etc..) pour mieux renverser tout cela. La question qui nous a traversé•e•s à chaque étape c’était : devrait-on plutôt avoir peur des sorcières ou bien de ceux qui les brûlent ?

On peut voir le cinéma fantastique à la fois comme le genre qui fait spectacle de la souffrance féminine et comme celui qui imagine le plus de portes de sorties face aux horreurs du monde réel. Est-ce que si l’on considère She Will à la fois comme un film fantastique et un commentaire sur le genre, cela vous convient ?
Le film d’horreur est en tout cas le genre qui me semblait le plus adéquat et le plus évident pour parler de la question du traumatisme, pour en capturer l’expérience. Le traumatisme, c’est une expérience unique : non-linéaire, qui bloque, qui inquiète, qui nous perd. Le choix du fantastique était donc avant tout une question d’honnêteté pour représenter cela. Par ailleurs, c’est aussi une question d’esthétique. L’incroyable créativité esthétique propre au cinéma d’horreur permet, comme vous le dites, une échappée vers un autre monde, mais aussi une investigation des rêves. Les rêves sont liés à la psychanalyse, à l’inconscient et à l’expérience de la guérison, qui sont également des thèmes que je voulais au cœur du film. Ce sont des phénomènes non-contrôlables.

Comment avez-vous travaillé avec votre chef opérateur pour traduire cette dimension physique de l’inconscient ?
La relation entre un cinéaste et son chef opérateur est si fondamentale. On parle quand même de confier ses propres yeux à quelqu’un, c’est incroyable ! J’ai donc passé beaucoup de temps à chercher la bonne personne car je voulais éviter de tomber dans les habitudes d’une esthétique trop anglaise. Je voulais que visuellement, on comprenne que l’on est en plein conte de fées mais qu’on ne sache pas pour autant à quel registre s’attendre.
Ma collaboration avec Jamie Ramsay a été toute une aventure ; la question abstraite de comment incarner des espaces oniriques s’est traduite par une série de choix très concrets : choisir les objectifs, le moindre mouvement de caméra, les cadrages, à quel moment utiliser le steadycam, les drones, etc. Puis plus tard, nous avons ajouté de brèves scènes composées d’effets visuels abstraits. J’ai travaillé sur ces derniers avec un collaborateur de Nicolas Roeg, on a fait ça directement dans sa cuisine avec un microscope et une caméra.

Vous êtes-vous autant impliquée dans la conception sonore ?
C’était fondamental, bien sûr, puisque tout le propos du film était de redonner une voix au passé. Pour vous donner une idée, lorsque l’on voulait traduire l’idée d’une terre qui serait vivante, on a en réalité placé des micros sur nos propres ventres, c’est donc le bruit de la digestion que l’on entend et qui donne cette idée d’une terre qui vit.

Plusieurs éléments du film font référence à Stanley Kubrick. Selon vous, qu’est-ce qui en faisait une référence intéressante pour aborder les thèmes du film ?
Je pense que c’est avant tout la présence de Malcolm McDowell qui apporte ces références-là. C’est un petit rôle dans le film mais Malcolm est tellement iconique, il charrie avec lui une imagerie tellement forte que cela traduisait parfaitement le déséquilibre entre elle et lui dont il est question dans le film, et qui existe bien sûr dans la vie réelle. Dans ce type de professions, devenir plus âgé n’a pas les mêmes conséquences pour les hommes que pour les femmes, sur le regard que l’on pose sur eux. C’est aussi bien sûr primordial dans le rapport qui oppose les victimes d’abus et leurs agresseurs. Souvent ces derniers parviennent à continuer leur vie tandis que les autres sont complément brisées par l’expérience, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.

Ce phénomène dont vous parlez est très présent dans le milieu du cinéma ici en France, où non seulement des artistes accusés d’agression sexuelle continuent d’être célébrés, mais plus ils avancent en âge plus leur statut iconique semble les rendre intouchables.
Oui. Ce qui est profondément terrible c’est que si la loi fonctionnait, on n’aurait pas besoin de mouvements comme #MeToo. Ce que je veux dire c’est qu’ idéalement, avant même de se poser la question de la place de ces artistes, on devrait se rappeler qu’un crime a été commis et qu’il doit y avoir des conséquences sociales.

En parallèle de ces sujets sérieux, She Will laisse aussi une place étonnante à l’humour. Quel rôle souhaitiez-vous donner à cet aspect du film ?
J’aurais adoré avoir la possibilité de passer beaucoup plus de temps avec toute l’équipe, car la dimension humoristique venait souvent d’eux. Rupert Everett est quelqu’un de tellement drôle, c’est un personnage incroyable et il était tellement grand ! Mais c’est vrai qu’une partie vient aussi bien sûr du scénario. On s’est amusées avec Veronica et son coté très bitchy, comme on dit en français ? Son coté malpoli (rires) ?

A quel stade du film Dario Argento s’est-il greffé au projet ?
C’était une rencontre géniale. Avant même de le rencontrer, j’avais en tête pour She Will le style de typographies qu’il utilise souvent dans ses films et que j’adore. Il était présent au Festival de Locarno pour sa toute première expérience d’acteur pour Vortex, et de notre côté She Will a remporté le prix du meilleur premier film. C’est à ce moment-là qu’il l’a découvert. Il nous a apporté énormément de soutien, c’était magique.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 25 novembre 2022. Un grand merci à Molka Mhéni. Source portrait.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |