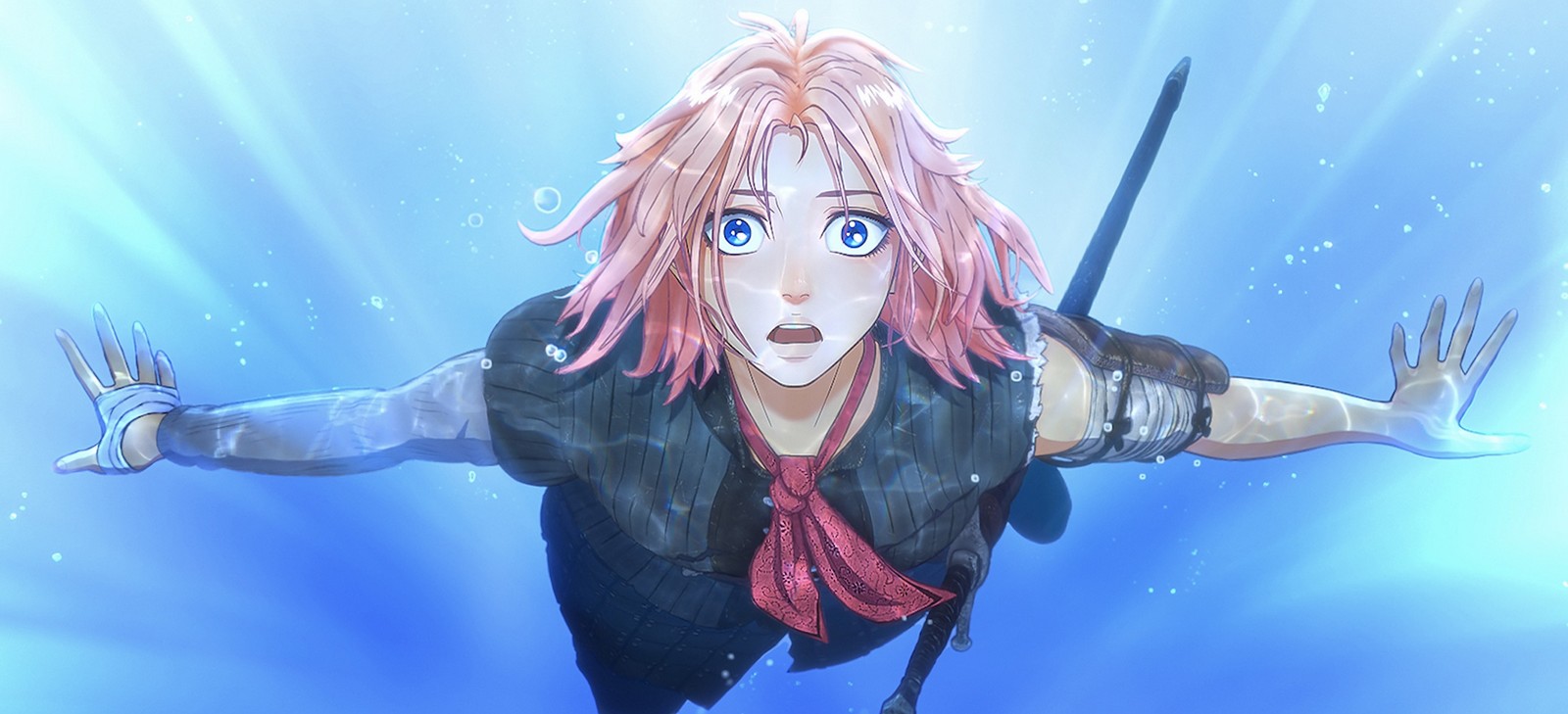La réalisatrice française Audrey Diwan a remporté le Lion d’or à Venise pour sa formidable adaptation du célèbre récit autobiographique d’Annie Ernaux, L’Événement, en salles le 24 novembre. Nous l’avons rencontrée à l’occasion de la présentation du film au Festival de La Roche-sur-Yon.
Je voudrais commencer par vous parler d’un choix esthétique qui frappe d’emblée dans L’Événement, c’est ce cadre très resserré. Qu’est-ce qui vous a amenée à choisir ce format 1:37 ?
Ce choix avait plusieurs intérêts pour moi. Le premier c’est que je voulais me concentrer sur mon personnage, Anne. Je voulais aussi éviter le coté reconstitution qui m’intéressait moins, or la latéralité amène à poser le regard sur le décor. Quand j’ai lu le livre d’Annie Ernaux, l’une des dimensions qui m’a frappée c’est son suspens insoutenable. Or, j’ai la sensation que ce cadre peut servir ce suspens : quand il n’y a pas de latéralité, les personnages surgissent à l’image et je me retrouve dans la peau de mon personnage qui est saisi par l’arrivée de quiconque croise sa route. C’est encore plus vrai à mesure que l’on avance dans l’histoire, puisqu’elle ne sait jamais si les gens qu’elle va croiser vont l’aider ou faire de la délation.
Cela me plaisait pour une troisième raison : au début, la cadre intègre Anne dans le groupe, puis l’isole progressivement. Mon chef opérateur Laurent Tangy et moi avons décidé ensemble que plus on avançait dans son histoire, plus il viendrait se placer dans son dos, afin d’avancer dans la profondeur du champ et d’avancer avec elle vers l’inconnu. Tant et si bien qu’à chaque fois qu’elle pousse une porte, on la pousse avec elle sans savoir ce qu’il y a de l’autre côté. Il me semble que plus on avance dans le film, plus j’utilise le cadre comme un cadre de pression, un cadre de contrainte. Pour moi c’est un cadre très narratif qui porte le sens du film.

Un autre effet saisissant de ce cadre, c’est qu’il vient rappeler qu’il s’agit pour Anne d’une expérience corporelle, sensorielle.
Oui. En fait il y a deux choses qui m’intéressaient particulièrement. L’avortement bien sûr, mais je ne voulais pas que le sujet englobe le film. L’autre dimension à traiter c’est celle du plaisir. Les deux sont d’ailleurs liés : le sensoriel et le sensuel. La question du plaisir féminin est liée à celle de la liberté. Le parcours d’Annie Ernaux est celui d’une transfuge de classe, il y a là la liberté de s’emparer de son parcours intellectuel.
En tant que réalisatrice, comment avez-vous trouvé votre rythme idéal pour retranscrire le sentiment d’urgence qu’il y a dans le récit d’origine ?
Je me suis trompée au début. Mais j’aime bien me tromper, c’est de façon empirique que je trouve les bonnes solutions. L’ouvrage d’Annie Ernaux s’appuie sur la forme du journal, il y a une forme de syncope, c’est très nerveux. J’avais donc écrit une toute première version, que je n’ai jamais fait lire car je n’en étais pas contente, avec des scènes très courtes, comme si je voulais singer cette urgence. J’ai compris que c’était exactement l’inverse qu’il fallait faire. L’urgence, on la connaitra puisque c’est le pacte que je noue avec le spectateur. Il faut au contraire que je traite les choses dans la longueur, puisque les autres personnages autour d’Anne ont tout leur temps, eux. C’est ça qui va nous faire ressentir que pour Anne, chaque seconde compte. J’ai inversé le processus narratif.

Comment avez-vous travaillé avec Anamaria Vartolomei, qui interprète Anne, sur la dimension souvent très physique du film ?
On a commencé par la travailler intellectuellement, en amont du tournage. Pendant le confinement, il y a eu plusieurs mois où on se parlait un jour sur deux. On parlait de films, de livres, de références qui m’importaient, qui lui importaient aussi. On a créé le personnage à partir de goûts communs et de séquences qui nous avaient marquées, d’images et de mots qui résonnaient. Puis on a commencé à s’interroger sur la dimension charnelle du personnage : comment elle se positionne, ses pieds, ses épaules, son regard par en-dessous comme si elle regardait toujours l’horizon qu’elle souhaite atteindre.
On a fait un travail dans le corps mais sans pour autant répéter des séquences qui, à mon sens, ne devaient jamais être mécanisées. Dans chaque film il y a des rendez-vous. Or ces rendez-vous, je me méfie de trop les travailler en amont. D’abord parce que quand les choses sont programmées, je les trouve moins séduisantes, il faut que je me sente un peu libre. Ensuite, parce que l’on déflore des émotions qu’il va pourtant falloir garder intactes. Déjà que je fais beaucoup de prises, et qu’on va devoir lutter contre la mécanisation sur le plateau, j’ai peur qu’on abime les choses en les répétant trop.
Pour moi, la valeur-clé sur un plateau c’est le temps. Or, quand on n’a pas énormément d’argent, ce qui était notre cas, on n’a pas énormément de temps. Il fallait gérer le temps et ne pas se laisser dépasser par l’envie d’aller vite. Il y a eu un travail de recherche à faire et il fallait prendre le temps de le faire, et on a pris beaucoup de temps pour essayer des choses. Pour prendre l’exemple de certaines scènes : mon idée première, c’est que la douleur faisait forcément crier. Or ni Anamaria ni moi n’étions satisfaites de ce que cela donnait. On s’est assises l’une en face de l’autre et on a cherché ensemble. De là est venue une autre idée : Anne a peut-être peur de s’évanouir et elle cherche l’oxygène qui va lui manquer. C’est en faisant des tests face-à-face qu’on trouvait ce qui était juste.

Vous parliez à l’instant de références qui vous sont chères, est-ce que vous pourriez les partager ?
Bien sûr. Le film dont a le plus parlé c’est Sans toit ni loi d’Agnès Varda, pour l’identité du personnage et sa détermination à rester libre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si j’ai demandé à Sandrine Bonnaire de bien vouloir jouer la mère d’Anne. On a parlé de Rosetta, d’Elephant, de Fish Tank, du Fils de Saul. Je suis cinéphile, et ce que je préfère faire au monde c’est regarder des films à 6 heures du matin quand tout le monde dort, j’ai l’impression qu’ils rentrent mieux en moi (rires). J’adore me servir de tout ça, mais seulement dans la mesure où ces films constituent un éclairage sur ce que je cherche à atteindre.
Passer d’un essai autobiographique, possédant une dimension sociologique, à un scénario de pure fiction était un défi. En tant que scénariste, quelle a été votre méthode pour accomplir cette tâche ?
J’ai été vraiment aidée par ma coscénariste Marcia Romano. J’ai longtemps réfléchi à ce projet : pourquoi adapter ce livre, pourquoi moi, pourquoi maintenant ? Des questions fondamentales, et j’avais besoin de cette vertu. C’est marrant, pour une scène de mon premier film, je devais choisir un livre à mettre dans le sac de Céline Sallette, et j’ai justement choisi L’Événement, que j’avais déjà lu et déjà bien en tête. Quand j’ai commencé à parler du projet d’adaptation avec Marcia, je lui ai tout de suite dit que je souhaitais raconter cette histoire au présent, et tenter d’être mon personnage plutôt que de simplement le regarder. Me mettre à la place du personnage, cela ne veut pas dire pour autant annuler le regard de la réalisatrice sur le personnage, mais plutôt faire concorder le regard que je pose sur cette jeune femme et le regard qu’elle pose sur elle-même. On a assez vite interrogé fond et forme, et cela nous a tout de suite sorties du récit autobiographique.

J’ai cru lire que vous aviez également puisé une partie de votre inspiration dans d’autres ouvrages d’Annie Ernaux ?
J’ai beaucoup lu Annie Ernaux, ce qui me permettait d’avoir des éléments de réponses face à des absences, comme sur la dimension sexuelle et sensuelle par exemple. Dans le livre L’Événement, il n’y a pas d’histoire de plaisir au présent. L’œuvre d’Annie Ernaux est une œuvre vaste et rigoureusement autobiographique, on y trouve des indices. Créer des prolongements et piocher ce qui pouvait manquer était donc d’autant moins complexe que j’avais à disposition la propre parole d’Annie Ernaux : Passion simple et Mémoire de fille, situés quelques années après, et La Femme gelée, situé quelques années avant L’Événement, où elle parle d’elle-même petite fille. Si j’analyse transversalement, j’ai déjà une idée de ce parcours de jeune femme qui découvre sa sexualité.
Ensuite, j’en ai beaucoup parlé avec elle. Il y a notamment une scène que j’ai rajoutée : la scène de masturbation féminine avec le traversin. Louise Orry-Diquéro a d’ailleurs été très courageuse dans cette scène. Comme la sexualité était taboue à l’époque, je voulais que cette question surgisse très progressivement dans le film. Au départ on ne fait qu’en parler, ensuite arrive l’image glissée dans un livre, puis une jeune fille le mime, et enfin le personnage est prêt à s’emparer de son désir et on aboutit à l’acte sexuel.
Par ailleurs, et c’est fondamental pour moi , quand on met en scène une scène de sexe, il faut savoir ce qu’elle raconte dramaturgiquement. L’erreur à laquelle je me suis heurtée par le passé, et ce que j’ai vu souvent raté ailleurs, c’est de l’oublier. En tant que scénariste, chaque scène que l’on écrit est forcément dramaturgisée : si je dis « ils dînent tous ensemble », je vais raconter ce qu’ils se disent et ce qui se joue au diner. Or très souvent, on s’arrête aux portes de la question sexuelle, on dit juste « ils font l’amour, ils baisent ». Mais pour pouvoir mettre en scène ces scènes-là, il faut savoir ce qui se joue entre les êtres. Il faut avoir une pensée du corps. C’est pour cela que j’ai greffé cette scène du traversin, qui pour le coup est plutôt issue de mon vécu à moi.

Vous parlez de discussion avec Annie Ernaux, a-t-elle eu un rôle de consultante, ou du moins un regard participatif, sur le travail d’adaptation ?
Elle a eu un regard, c’est sûr. Elle a accepté le faire et j’en suis très heureuse. Je lui ai d’abord présenté mon projet, pour m’assurer qu’on regardait dans le même direction, que je ne m’emparais pas de son histoire pour l’emmener dans une direction qu’elle n’aurait pas souhaitée. Je n’aime pas les processus violents, je n’aime pas voler aux acteurs ou aux actrices ce qu’ils n’ont pas envie de me donner, ni aller dérober une histoire à quelqu’un qui l’a vécue. C’était délicat de savoir comment manipuler cette matière-là, et comment m’inscrire là-dedans.
Elle a accepté de retracer la chronologie du livre en éclairant des angles morts. Je voulais du hors-champ. Je me posais des questions sur ce qui n’était pas directement dans le livre : des questions politiques, sociales, sociétales. Elle a lu trois versions, avec l’intelligence qui la caractérise, c’est à dire jamais dans le but d’amener le scénario au livre mais plutôt en pointant des choses qui éventuellement ne lui semblaient pas justes. « Juste » étant vraiment le mot qui a guidé notre travail. Elle me pointait le chemin.
Le travail de reconstitution historique du film est très discret. Comment avez-vous trouvé le dosage idéal dans cette manière d’évoquer un passé qui pourrait passer pour du présent ?
Le but était justement de trouver des moyens de créer cette passerelle entre passé et présent. Quand je ferme les yeux et je visualise l’histoire d’Anne, elle m’apparait au présent. Ça a été un travail très transversal avec toute l’équipe : la chef décoratrice Diéné Bérété, la chef costumière, la scripte… on a toutes dû chercher comment éviter en même temps l’anachronisme et le pastiche. C’était une pensée commune qui valait aussi pour les comédiens et les comédiennes : comment parler sans essayer de jouer les années 60 et sans être contemporain.
C’est une pensée qui nerve et infuse à tous les endroits, comme la musique par exemple. C’est une demande que j’ai faite à chaque chef de poste. J’ai adoré ce questionnement. Par exemple : fallait-il mettre une date à l’écran ? J’avais l’impression qu’à partir du moment où on datait noir sur blanc, on posait le récit au passé de tel sorte qu’il serait impossible de remonter le chemin jusqu’à aujourd’hui. Dans le livre, Annie Ernaux raconte deux choses. Elle s’appuie sur son journal intime de l’époque, et en parallèle elle raconte de façon exégète comment elle cherche à atteindre le souvenir de la façon la plus juste possible.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 14 octobre 2021. Un grand merci à Gloria Zerbinati. Crédit portrait : Manuel Moutier.