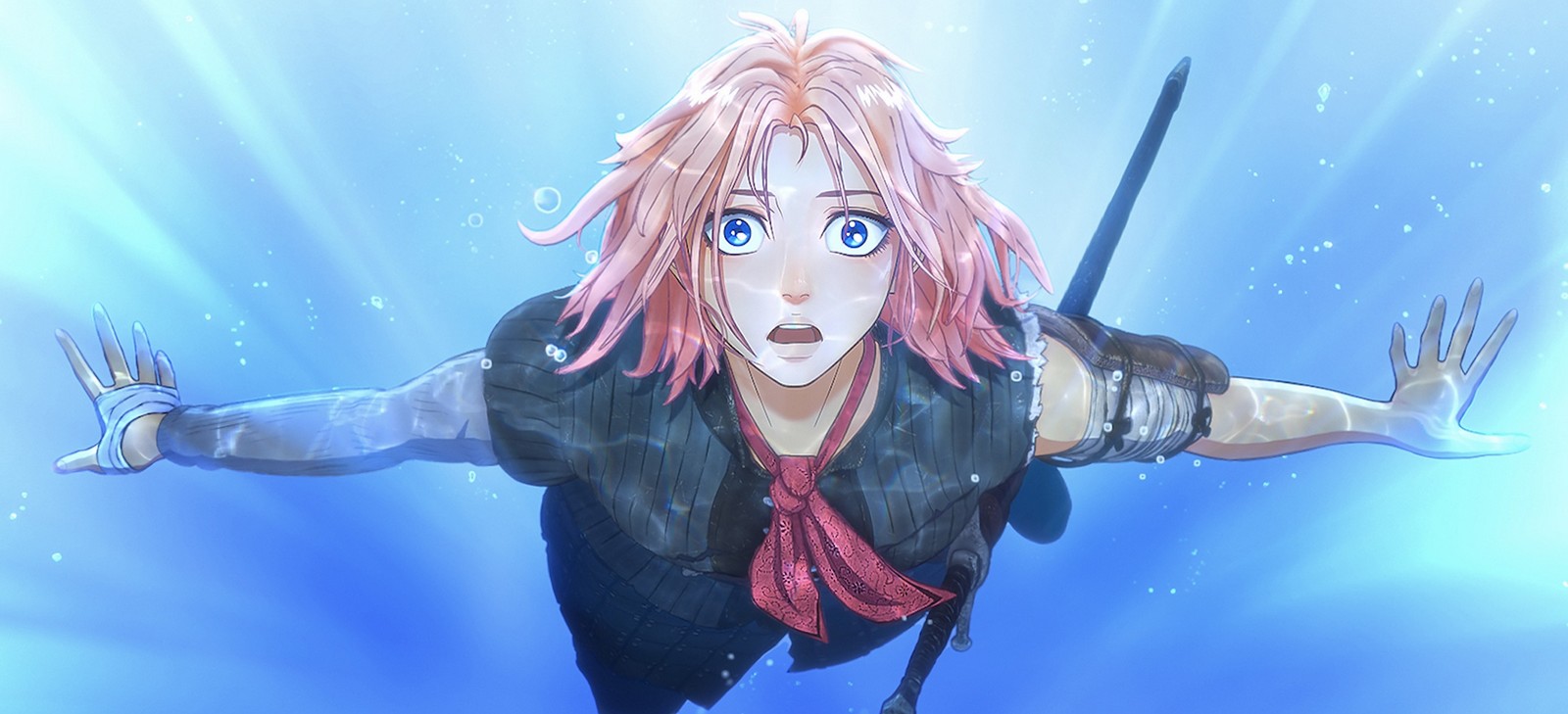Quelques années après son Grand Prix à Gérardmer et alors que sa sortie en salles avait été repoussée puis finalement annulée au cours de la crise sanitaire, Saint Maud de la Britannique Rose Glass est désormais disponible sur Mubi. Cette merveilleuse révélation horrifique raconte l’histoire de Maud, une infirmière très croyante, qui soigne Amanda, une danseuse fragilisée, à son domicile. Maud est persuadée qu’elle doit sauver Amanda. Rose Glass, qui s’est depuis distinguée avec le thriller Love Lies Bleeding, nous présente ce trésor.
Dans les premières versions du scénario, Saint Maud se déroulait dans les années 60. Qu’est-ce qui vous a poussée à déplacer le récit dans une époque finalement difficile à dater ?
J’ai commencé à travailler sur l’histoire de Saint Maud à la fin de mes études de cinéma. J’avais beaucoup d’idées et j’ai pensé à beaucoup de versions différentes. Si j’ai rapidement pensé aux années 60, c’est tout d’abord par goût personnel pour l’esthétique de cette époque. J’aime d’ailleurs particulièrement les films de cette période. En tant que réalisatrice, j’ai également vite réalisé l’impact particulier qu’il y avait à gagner à situer une histoire angoissante à une époque sans portables ni internet, où il existait tout simplement moins de moyens pour quelqu’un en danger d’appeler à l’aide. Par ailleurs, cela donnait plus de crédibilité à la vocation de nonne de Maud, mais c’est précisément ce point qui m’a finalement fait changer d’avis.
Je ne voulais pas risquer que le film devienne une explication de texte de pourquoi et comment ont pouvait devenir nonne à 25 ans dans les années 60, et puis surtout j’ai vu Ida, qui est le film ultime sur les nonnes des années 60 (rires). Impossible de faire mieux qu’Ida donc j’ai changé de voie. Au final, le film conserve bien sûr une esthétique rétro qui m’est chère, mais le personnage de Maud est finalement très contemporain. Son besoin d’être connectée à tout prix à ce qui l’entoure est psychologiquement beaucoup plus proche d’aujourd’hui que des années 60.

Comment avez-vous trouvé votre maison idéale ? Qu’est-ce que vous cherchiez ?
A la base, je n’avais pas spécialement imaginé que cette maison se trouverait au bord de la mer. L’histoire devait se dérouler en plein centre ville, avec plein de voisins. J’ai finalement volé cette idée à la personne qui me l’a suggérée, parce que ça collait quand même drôlement bien avec l’isolement des personnages. La maison du film est réaliste, comme une maison qui existe vraiment dans certaines régions, mais jusqu’à un certain point. Quand Maud y pénètre pour la première fois, la mise en scène suggère qu’il s’agit d’une bonne vieille maison hantée et qu’on est en plein film d’horreur, mais je prends plaisir à tirer ce tapis sous les pieds des spectateurs pour les emmener ailleurs.
Pour les plans de loin, on a utilisé une vraie maison qui se trouve dans le Nord du Yorskshire, on a simplement modifié le chemin qui mène à l’entrée pour la rendre plus bizarre. Les intérieurs ont été tournés à Londres, en revanche. Le reste, c’est la magie du cinéma.

Saint Maud dépeint la foi comme un pouvoir surnaturel, celui de donner vie, en chair et en os, à ses croyances. D’après vous, peut-on y voir une métaphore du cinéma fantastique ?
Oui, c’est une métaphore du cinéma en général, mais surtout du fantastique. Prendre une peur psychologique, inconsciente, et la transformer en image concrète, c’est la recette-même du cinéma d’horreur. Tous les plus grands films d’horreur parlent d’ailleurs de quelque chose de plus grand qu’ils n’en ont l’air, de peurs universelles. On est bien d’accord que Zombie de Romero parle de la société de consommation, et pas juste de morts-vivants, non ? C’est ce que j’adore dans le cinéma, transformer quelque chose d’abstrait en élément tangible. Le cinéma est pour moi le seul art à pouvoir faire cette transposition, même si bien sûr il hérite une large part de ce pouvoir de la littérature.

On n’est jamais vraiment certain que ce que l’on voit à l’écran appartienne à la réalité ou à l’imaginaire de Maud. Parvenir à trouver l’équilibre idéal pour cette ambiguïté, c’était d’avantage une question d’écriture ou de mise en scène ?
C’était avant tout une question d’écriture, et je peux vous dire que ça a été un processus sans fin. J’ai toujours su que le film serait vu intégralement du point de vue de Maud. Au final, seules les dernières secondes du film sont vues d’un point de vue plus réaliste. Au fil des différentes versions du scénario, j’avais envie de rajouter plein de visions plus folles les une que les autres, par exemple j’avais envie que Dieu descende réellement sur Terre pour mettre une claque à Maud, mais au final, l’ambiguïté dont vous parlez était bien sûr plus précieuse que tout.
J’adore cette incertitude. C’est comme ça que m’est venue l’idée de la scène de lévitation. A ce moment-là du film, Maud est au 36e dessous, elle n’est même plus certaine d’avoir la foi. Ce qui lui arrive, c’est comme si Dieu venait bel et bien la secouer par les épaules en lui hurlant « mais secoue-toi ma fille ! ». Je ne voulais pas aller trop loin visuellement, mais cette scène c’est comme si Dieu venait carrément lui donner un orgasme. Bon selon sa logique à elle en tout cas. Peut-être que la logique de Dieu est identique (rires).

Morfydd Clark offre une incroyable performance. Comment avez-vous travaillé avec elle ?
Je ne sais pas si je suis censée dire ça, mais ça ne ressemblait pas à du travail. C’était plutôt du jeu. Comme elle était prise sur un autre projet, on a dû attendre qu’elle se libère, ce qui fait qu’on a eu très peu de temps pour répéter. Nous avons juste passé 3 jours ensemble elle et moi à lire le scénario, mais elle est arrivée en ayant déjà tout compris. On m’avait dit qu’en tant que cinéaste, si j’engageais l’interprète idéal et qu’elle comprenait le scénario, alors tout mon travail serait déjà fait. C’était vrai.
Son jeu est très versatile, ce qui était idéal car le film est parfois très théâtral et n’a pas peur du ridicule, il s’approche presque du rire par moment. Elle avait également beaucoup d’intuition : après une prise réussie, je la laissais souvent faire une prise supplémentaire en la laissant libre de s’éloigner de ma vision. Or ce sont « ses » scènes qu’on a fini par garder au montage, parce qu’à chaque fois elle les rendait meilleures. C’était très humiliant pour moi en tant que réalisatrice (rires).

Au dernier festival de Gerardmer, le film a remporté de nombreux prix, dont celui de la meilleure musique. Pouvez-vous nous en dire plus sur l’habillage musical, et par extension le traitement sonore que vous souhaitiez ?
La musique est signée Adam Janota Bzowski et c’est son tout premier film. Je crois qu’avant ça il n’a fait que de la publicité, ou presque. La question de la musique ne s’est posée qu’en post-prod. On a rencontré différents compositeurs, dont certains avec beaucoup plus d’expérience, on leur a envoyé non pas un premier montage ou même le scénario, mais simplement un moodboard.
En retour, Adam nous a envoyé des démos qui collaient tellement bien qu’on les a presque gardées telles quelles. Il arrivait particulièrement bien à rendre cet effet de souffle, que je ne saurais pas comment décrire (elle imite avec sa bouche, ndlr). Vous voyez ce genre de sons qu’on entend dans le film ? Ils étaient déjà dans ses démos. Au moment du montage, Mark Towns et moi avons tout simplement pioché dedans, un peu comme si on travaillait avec un ingénieur du son. Là encore, ça a été une collaboration très fluide.

Qui sont les cinéastes qui vous inspirent le plus ?
Cronenberg, Scorsese, Lars Von Trier, Polanski, Hitchcock, Russell, Haneke, Roeg… en fait je crois que j’aime les dictateurs (rires). J’admire les cinéastes égocentriques qui imposent leur vision, jusque dans le traitement visuel de leur film. Les films où l’on à l’impression que la caméra est invisible, ça ne m’intéresse pas.
J’aime aussi beaucoup John Waters. Female Trouble figure dans le top 20 de mes films préférés au monde, mais je crois qu’encore plus que ses films, c’est lui-même qui me fascine. Ado, j’ai lu beaucoup d’interviews de lui, et sa manière joueuse et moqueuse d’aborder l’art cinématographique m’a énormément parlé. J’étais à un âge où on admire forcément les personnes rebelles, mais il se trouve qu’à l’époque j’étais moi-même en train de bricoler mes mini-films trash et queer sans aucun budget avec ma bande de potes. J’ai même fait mon mémoire de fin d’étude sur lui. Ça s’appelait Analyse du thème du crime dans les films de John Waters. C’était un très mauvais travail, je n’avais vraiment fait aucune recherche (rires).

Avez-vous un nouveau projet ?
Oui, je suis en train de coécrire un nouveau scénario de long métrage. C’est une romance, mais avec quelques éléments fantastiques. J’espère pouvoir le tourner l’an prochain, mais ça se passe aux États-Unis, donc c’est difficile de prédire quand ça pourra vraiment se faire.
Quel est votre film d’horreur préféré ?
Ça ne va pas m’attirer des ennuis si je cite Roman Polanski en France ? Parce que mon film d’horreur préféré c’est de loin Rosemary’s Baby. Il y a dans ce film quelque chose d’un peu naïf, presque bêta, et en même temps une grande confiance dans la théâtralité. A mes yeux c’est l’équilibre de cinéma le plus pur, le plus idéal.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 11 décembre 2020. Un grand merci à Robert Schlockoff.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |