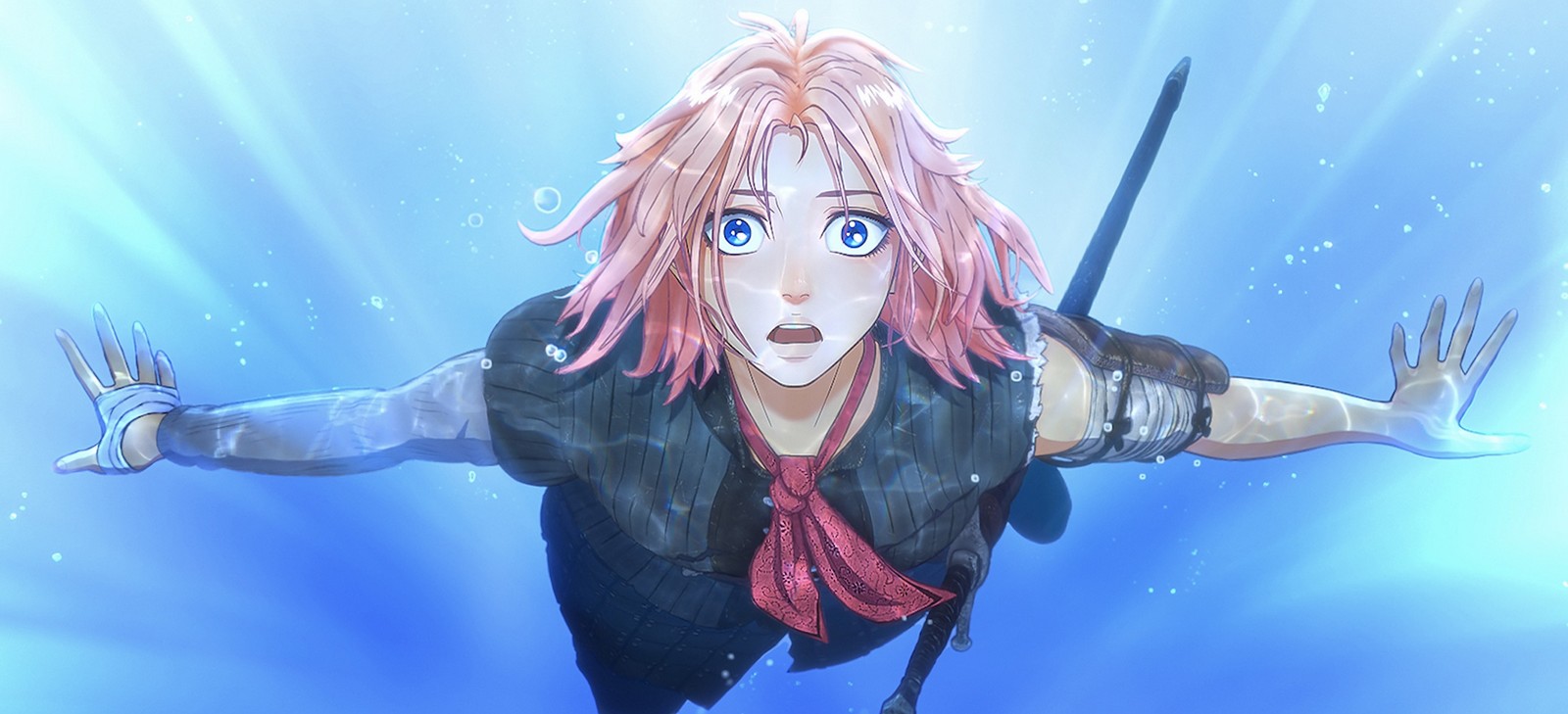Primé l’an passé dans l’excitante compétition Encounters de la Berlinale et auteur d’un brillant parcours en festivals, Désordres est un ovni suisse qui ne ressemble à rien de connu. Comédie rêveuse et absurde, récit historique sur un mouvement anarchiste qui ne ressemble jamais à un film historique, c’est un film au charme unique que nous présente son réalisateur Cyril Schäublin. Désordres est visible dès maintenant en salles.
L’un des aspects les plus inattendus de Désordres et peut-être son humour, quelle place avez-vous souhaité laisser à cette dimension ludique ?
J’aime beaucoup Tchekhov, notamment ses pièces courtes. Quand il a commencé à écrire et faire jouer ces dernières, les gens ne comprenaient pas s’il fallait rire ou non. Bien sûr, je ne vais pas me comparer à Tchekhov, mais si nous avons un point commun, je dirais que cela tient à une sorte de situationnisme. Être humain, avoir un corps humain, je trouve que c’est quand même une expérience bizarre, on ne devrait jamais oublier que c’est très bizarre (rires).
Mais l’humour a aussi un autre rôle. Nos vies quotidiennes sont remplies de petites fictions, de scénarios que l’on joue comme une performance et sans même s’en rendre compte. Interagir avec de machines, devoir montrer ses papiers d’identité, ces scénarios quotidiens nous sont imposés par le capitalisme, et ils sont franchement bizarres. Le moment où l’on réalise que nos vies quotidiennes qui nous paraissaient normales obéissent en fait à plein de constructions sociales, c’est très drôle. Drôle et tragique à la fois.

Tchekhov disait en effet qu’il ne comprenait pas pourquoi les spectateurs sortaient déprimés après avoir vus ses pièces, au lieu d’en rire.
Oui, c’est ça qui est beau avec ses pièces : on ne sait pas vraiment si c’est drôle ou pas, tout dépend le lecteur et du spectateur. Il y a une ambigüité dans l’air.
Désordres est un film suisse qui se déroule dans le milieu de l’horlogerie, mais il ne ressemble jamais à ce à quoi on croit devoir s’attendre avec un tel postulat. Prendre autant que possible le contrepied par rapport aux archétypes, c’était quelque chose qui vous tenait à cœur ?
Dans leur célèbre conversation, Hitchcock et Truffaut disaient qu’il valait mieux commencer par un cliché que de conclure avec, et c’est une formule à laquelle je pense souvent. J’ai passé plusieurs années à vivre en dehors de la Suisse. J’étais en Allemagne et en Chine et c’est justement là-bas, en discutant avec des amis sur nos familles respectives, que j’ai réalisé que l’image de la Suisse reste encore aujourd’hui liée aux banques, au chocolat et aux montres. Or il se trouve que je viens bel et bien d’une famille d’horlogers. On dirait que j’invente mais c’est la vérité.
J’estime donc important de ne pas tenter de cacher les archétypes sur la Suisse, même si la vraie vie n’est jamais un cliché. Je voulais au contraire parler dans mes films de ce que je connaissais : le monde des banques dans mon premier long métrage Ceux qui vont bien et celui de l’horlogerie dans Désordres. Et puis un cliché, ça peut être beau et drôle. Peut-être que c’est plus facile de présenter d’abord un film sous l’angle d’un archétype familier ?

Vous disiez qu’il y a à vos yeux quelque chose de bizarre à avoir un corps humain. Peut-on rapprocher cette notion de la manière particulière dont vous cadrez vos personnages, souvent à la lisière du cadre ou loin dans le champ ?
Pour préciser ma pensée : ce qui est bizarre c’est de devoir composer avec un corps humain à l’intérieur d’un système qui a été créé dans les débuts du capitalisme ou de l’industrialisme. Comment parvenir à concilier ce qui est naturel et ce qui relève de la construction ? Mon chef opérateur Silvan Hillmann et moi on essaie d’être le plus transparents possible sur un certain point : ne pas cacher qu’on travaille aussi avec des machines, avec une technologie, avec du chronométrage, etc. On joue avec cela et le cadre en est un exemple. Un cadrage c’est toujours une question d’exclusion : qu’est-ce qu’on met dans le cadre, qu’est-ce qu’on exclut ? Mes cadrages sont statiques car j’ai le désir que la machine soit également présente d’une certaine manière.
Jouer avec les marges et le centre c’est pour moi une invitation à se poser la question « Qui a fait cette image ? », a fortiori dans le cadre d’un film historique. Je veux que mes images posent la question « Qu’est-ce que l’Histoire ? Qu’est-ce que la vérité historique ? Qui choisit quels sont les éléments fondamentaux à retenir, quelles informations du passé sont importantes pour le futur ? ». Toutes les images du film sont strictement préparées à l’avance, et les personnes qui rentrent dedans ne sont pas des acteurs professionnels, ce sont soit des amis soit des habitants de cette région. On ne sait jamais exactement ce qu’ils vont dire ou comment ils vont se déplacer, ce qu’ils vont apporter à l’intérieur de ces images très mécaniques. J’aime beaucoup travailler avec cette fragilité, cette incertitude-là.
Comment dirigez-vous vos acteurs ? Leurs déplacement obéissent-ils à quelque chose de mécanique aussi ?
Oui. Mais on a beau dire aux acteurs « allez là-bas, dites cela ou faites ceci », il y a toujours quelque chose qu’on ne peut pas contrôler, surtout avec les acteurs non-professionnels. Des fois ils se mettent à jouer de façon très visible et je les arrête en leur disant qu’il ne faut surtout pas jouer (rires). Il faut trouver une langue commune pour chaque situation et c’est quelque chose qui est difficile à exprimer. Ce que je cherche c’est une sorte violence entre les gens, une violence qui nait de l’incertitude. Quand les gens doivent d’un coup chercher leurs propres mots et s’adapter à des situations incertaines. L’incertitude je trouve ça plus fort que tout.

Que voulez-vous dire quand vous parlez de violence ?
Je crois qu’en Suisse il y a une certaine violence, qui n’est certes pas physique mais qui est beaucoup plus efficace qu’une violence physique. Chaque jour, dans les espaces publics il faut être sans cesse très mesuré, sous peine d’être jugé par autrui. Je trouve ça vraiment incroyable que tout le monde continue à perpétuer ce système jour après jour. C’est une sorte de violence tendre ou chaleureuse que l’on retrouve partout en Suisse.
Vous parlez de douceur et de chaleur, et je voulais vous interroger sur votre travail sur la lumière, qui va justement dans ce sens.
Depuis mon premier long métrage, je ne travaille qu’avec de la lumière naturelle, et je crois que c’est pour des raisons économiques (rires).
Toutes les scènes de Désordres ont vraiment été tournées en lumière naturelle ?
Mais oui. Avant d’entrer en école de cinéma j’ai travaillé comme chef électricien sur des tournages et j’ai trouvé ça horrible (rires), toute cette machinerie, tous ces camions, tout ce temps passé à attendre de trouver la bonne lumière… Aujourd’hui je préfère travailler sans lumière artificielle, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de travail. A l’étalonnage, on a fait beaucoup de color grading par exemple. Ce travail sur la lumière naturelle et devenu possible grâce aux nouvelles technologies. Avec les dernières cameras, on peut faire des choses qui étaient impossibles il y a dix ou quinze ans.

Est-ce que le rythme du film est également quelque chose que vous construisez méticuleusement en amont ?
Plus qu’un rythme, c’est une certaine ambiance que je recherche, et c’était déjà la même dans Ceux qui vont bien et dans mes courts métrages. C’est le même territoire. Et effectivement, tout est déjà là avant le tournage. Pour autant, je dois dire que j’adore l’étape du montage, c’est vraiment le travail le plus facile pour moi. Tout est déjà là, il suffit de suivre le fil. Je ne crois pas qu’on pourrait monter un autre film que celui-ci avec le matériau que j’avais tourné.
Le titre aussi était-il présent à votre esprit dès le départ ?
Oui, aussi. Beaucoup de femmes de ma famille ont travaillé comme régleuses, elles devaient s’occuper du balancier. En suisse allemand, balancier se traduit par Unrueh (titre original de Désordres, ndlr), mais ce mot signifie aussi agitation et inquiétude, ce que l’on perd à la traduction.
Les faits historiques dont s’inspire Désordres, sur la naissance du mouvement anarchique, sont-ils connus en Suisse ?
Non ce n’est vraiment pas très connu. C’est connu peut-être un peu dans la région de l’industrie horlogère car Kropotkin y a sa statue, et peut-être que les gens de la gauche s’y intéressent aussi, mais ce n’est pas du tout quelque chose qu’on enseigne à l’école, où ce que l’on apprend de l’Histoire de la Suisse remonte plutôt aux batailles du Moyen-Âge. Ce qui est bizarre parce que l’histoire du syndicalisme c’est quand même fondamental dans l’histoire d’un pays, non ?
Les débuts du mouvement anarchiste ont eu lieu en Suisse et les tout premiers syndicats sont nés dans l’industrie horlogère. On en revient à la question de ce que l’on décide qui mérite d’être retenu dans l’Histoire. Par exemple comment naissent les jours fériés ? Comment décide-t-on ce qui doit devenir un jour férié ? Je trouve ça passionnant. Que l’on choisisse de commémorer une bataille très ancienne où la Commune de Paris, cela relève d’une décision, donc d’une construction. Je crois que le film parle beaucoup de cette question : qu’est-ce qui définit le passé ? Comment définit-on le passé afin de mieux définir le présent ?

Un autre exemple de construction dans Désordres c’est cette histoire, elle aussi authentique, de village divisé par plusieurs fuseaux horaires…
L’heure de Greenwich a été inventée plus tard, dans les années 1890. Avant cela, c’était la même chose en France, en Italie ou partout : le soleil n’est jamais exactement au zénith au même moment selon que l’on se trouve à Lyon ou à Rennes, donc l’heure n’était jamais vraiment la même. Se fier au soleil n’était plus suffisant, il a donc fallu créer une heure nationale. Pour cela, on se servait du télégraphe en envoyant un message à tout le pays à midi pile. Aujourd’hui encore, il existe un bip bip à la radio qui nous permet de tous régler nos montres à la même heure. C’est effectivement un nouvel exemple de décision de créer quelque chose qui n’est pas réel.
Or, ceux qui peuvent définir l’heure sont ceux qui détiennent le pouvoir, puisque c’est une construction qui influe directement sur notre quotidien : à quelle heure faut-il se lever, manger, se voir…? Voilà les ingrédients qui ont donné naissance au capitalisme industriel : tout n’était que construction de choses irréelles.
Quel est le dernier film que vous avez vu et qui vous a donné l’impression de découvrir quelque chose de neuf, d’inédit ou d’excitant ?
C’est peut-être parce que je suis en France mais je dirais Saint Omer. J’ai eu l’impression de faire l’expérience d’un sentiment que je connaissais déjà mais que je n’avais jamais vu au cinéma. Le film parvient à rendre visibles des notions imaginaires, des grands fantômes de notre présent, tels que la juridiction ou l’État. Dans Saint-Omer, on peut presque toucher du doigt ces imaginaires collectifs, chapeau.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 11 avril 2023. Un grand merci à Cilia Gonzalez. Crédit portrait : Seeland Filmproduktion.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |