
Notre Lundi Découverte est dédié au jeune Thaïlandais Tulapop Saenjaroen. C’est également l’occasion pour nous de lancer notre semaine spéciale Locarno, consacrée aux temps forts de la dernière édition du festival. Saenjaroen a dévoilé son court métrage A Room with a Coconut View dans la section Signs of Life, dédiée aux projets hors normes. Et c’en est un ! De quoi rêvent les instruments de synthèse vocale ? C’est l’une des question d’une WTFuckerie cosmique posées par ce film dans lequel des voix robotiques s’entretiennent (l’une est guide touristique, l’autre est client) jusqu’à ce que la première perde le contrôle. C’est un cadavre exquis visuel qui cite Magritte, parvient en creux à évoquer la dictature, et révèle un cinéaste à suivre…
Quel a été le point de départ de A Room with a Coconut View ?
J’ai toujours voulu faire quelque chose en rapport avec la ville d’où je viens, et qui s’appelle Bangsaen. J’y suis né, mais en fait je n’ai jamais vraiment vécu là-bas. J’y ai passé seulement des weekends ou des vacances dans mon enfance. C’est un double sentiment qui m’intrigue : avoir l’impression d’être un touriste dans ma propre ville. Une impression qui est à la fois familière et étrangère, un questionnement permanent sur ce que signifie de se sentir à sa place. Ou d’avoir l’impression d’être un touriste partout ! Puis j’ai commencé à réunir des informations ou collectionner des formes de représentations de la ville.
Plus j’avançais dans ces recherches, plus je me suis intéressé à l’idée d’identité de la ville. Quelle esthétique générique, comment la mise en place de cette esthétique peut devenir une arme (et dans quel but). Comment la culture numérique joue un rôle dans ce procédé de représentation dans un régime dictatorial, etc… Le point de départ se trouve là, je pense : quand le portrait d’une ville touristique devient le portrait de la fabrication de ce portrait.

Le ton de A Room with a Coconut View est très surprenant. Votre film ressemble parfois à une farce absurde (et celle-ci est très drôle !) et peut ensuite avoir des questionnements philosophiques. Pouvez-vous nous parler de cet équilibre ?
A titre personnel, je pense que l’absurdité et le sérieux partagent une frontière très fine. Et l’on glisse très facilement de l’un à l’autre. Je pense que le ton du film résulte d’une collision entre les contextes globaux et locaux, entre le rationnel et l’irrationnel. Pour être honnête, l’équilibre dont vous parlez a été très intuitif. Je n’ai pas de formule particulière. C’est un dosage plus qu’une distribution minutieuse.
Et en ce qui concerne la préparation du film, j’ai tendance à travailler à la manière d’un essayiste. J’essaie d’associer les choses aussi largement que possible avant de chercher une direction. Par exemple, j’ai continué à collecter des images, des films, des images d’archives ou des textes sur la ville et j’ai choisi de ne photographier que des lieux populaires, comme s’il s’agissait de représentations génériques de la ville. Ensuite, j’ai revu ce que nous avons tourné et j’ai commencé à structurer les séquences, à écrire, à ajouter d’autres documents collectés en même temps – pour accentuer la reconstruction des matériaux. Donc, pour ainsi dire, les processus de préparation, de production et de post-production étaient en quelque sorte impossibles à distinguer. Peut-être que cette façon de travailler a modifié le ton du film ici ou là.
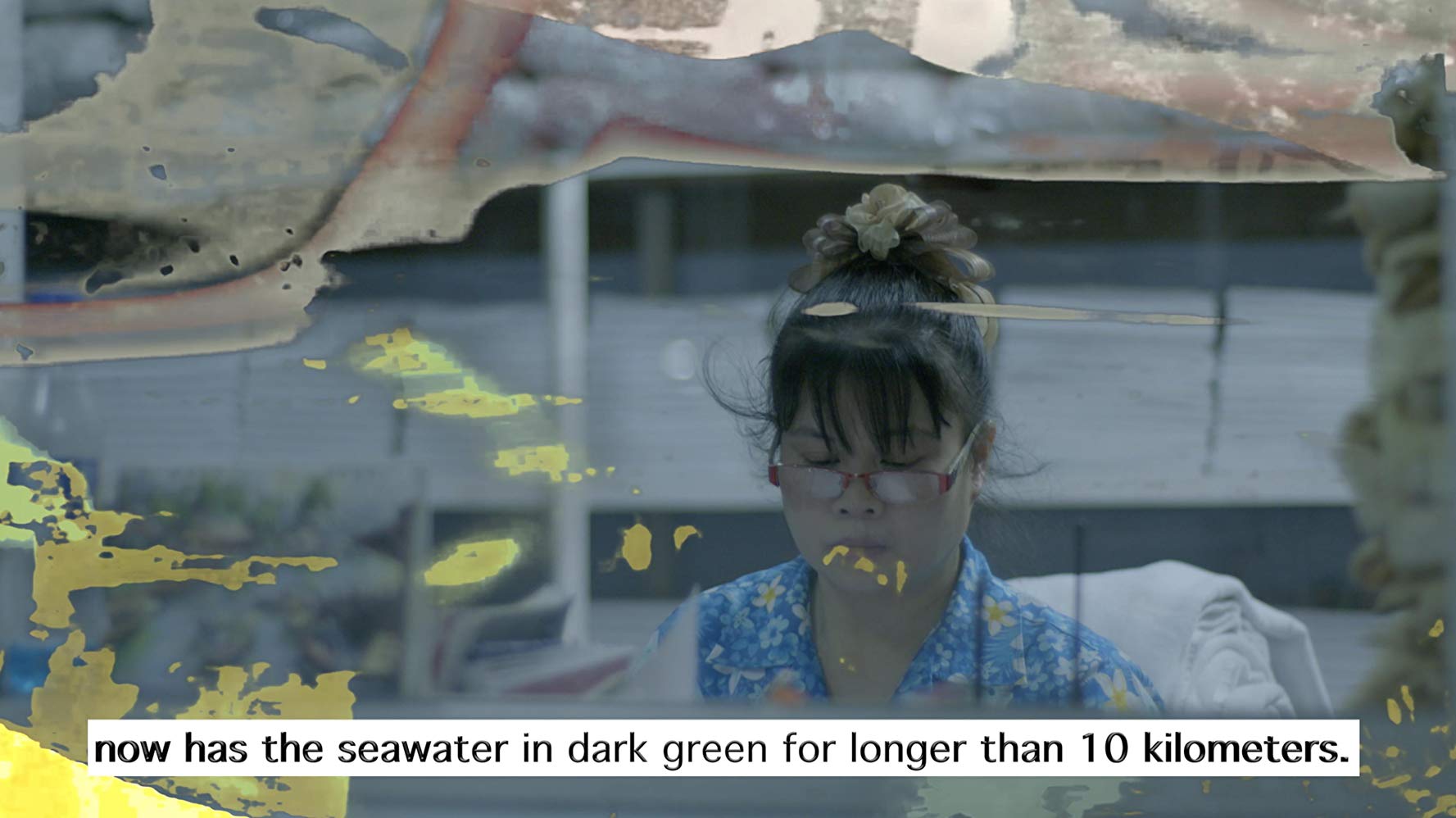
Vous avez travaillé auparavant avec Anocha Suwichakornpong, qui a ici produit votre film. Qu’avez-vous appris à ses côtés ?
Beaucoup, vraiment ! En fait j’ai débuté comme stagiaire sur son premier film, Mundane History, en 2008. Puis j’ai commencé à travailler sur d’autres projets avec Electric Eel Films. Avant cela, j’avais seulement fait des écoles d’art et n’avais aucune expérience véritable de travail sur une production cinématographique. Du coup, j’ai énormément appris auprès d’elle et de l’équipe, qu’il s’agisse du travail de mise en scène que de la gestion d’une équipe, ou même sur la vie en général ! Anocha est également quelqu’un qui encourage beaucoup et qui est très ouverte d’esprit. D’une certaine manière, grâce à elle, j’ai appris à croire davantage en ce que je fais et à avoir moins peur.
Quels sont vos cinéastes favoris ?
Les premiers noms qui me viennent à l’esprit sont Harun Farocki, Alain Resnais, Deimantas Narkevičius, Jennifer Reeves, Hong Sang-Soo, Anocha Suwichakornpong, et bien d’autres : c’est une liste sans fin. Leurs films sont exaltants, touchants et restent longtemps en tête.

Quelle est la dernière où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de neuf ou de découvrir un nouveau talent au cinéma ?
Je pense au court métrage Man in the Well et au long métrage An Elephant Sitting Still du Chinois Hu Bo. J’ai eu la chance de découvrir ces deux films durant la même semaine. Ils sont assez intenses. Et même s’ils sont assez différents en termes d’esthétique (au-delà du fait que l’un est un court et l’autre dure presque 4 heures), j’ai trouvé que les cœurs de ces deux films avaient quelque chose en commun. Ils sont uniques et d’une authentique audace.
Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 11 septembre 2018.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |







