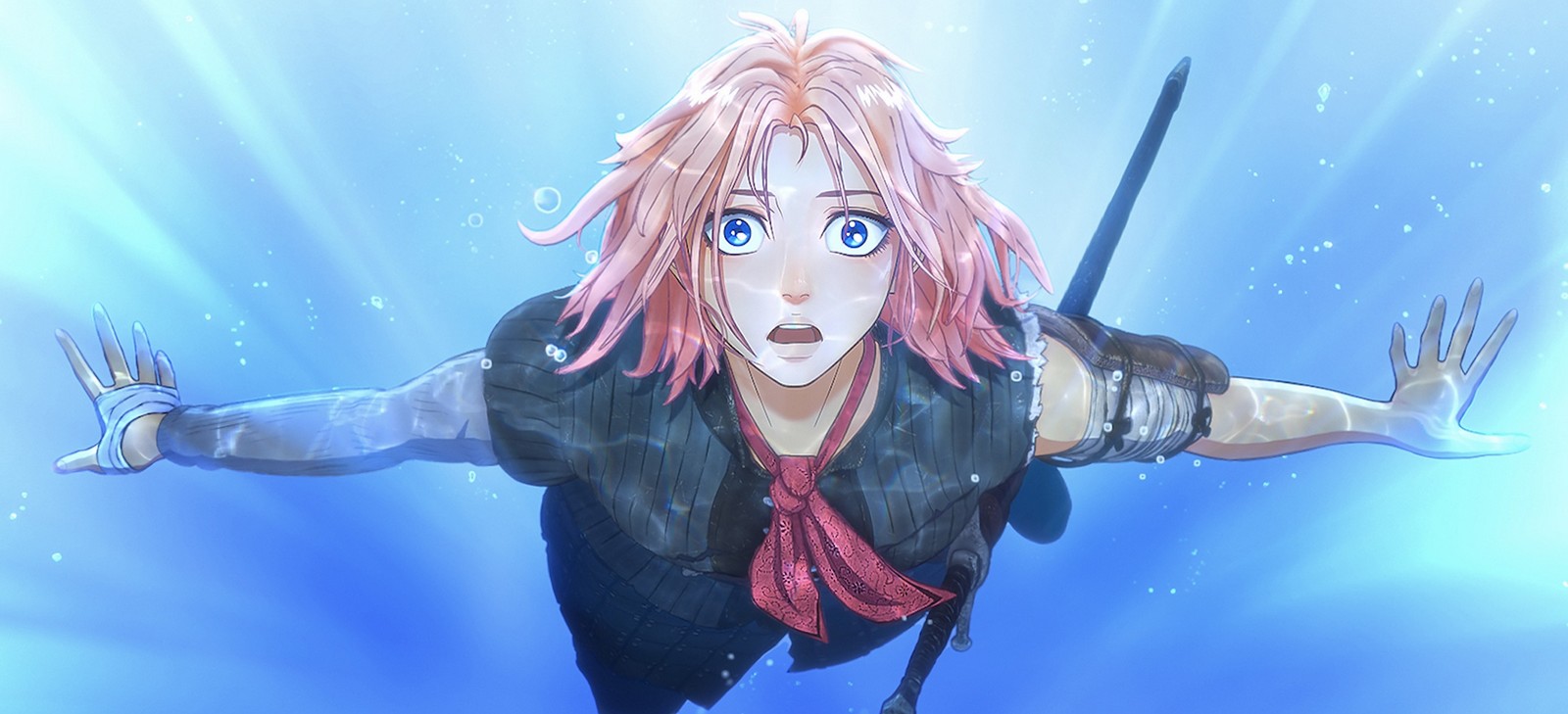Léopard d’or au dernier Festival de Locarno, Toxic est le premier film de la Lituanienne Saulé Bliuvaité et il s’agit de l’une des révélations de l’année. Ce long métrage suit le parcours de jeunes filles qui, pour échapper à la morosité de leur quotidien, espèrent devenir mannequins. A travers des cadres puissamment composés et un ton d’une brutale honnêteté, la cinéaste signe un récit d’apprentissage où les jeunes héroïnes se heurtent à un monde où les règles sont conçues pour qu’elles perdent. Saulé Bliuvaité nous en dit davantage sur ce film à ne pas manquer, en salles dès le 16 avril.
Vous avez déclaré que lorsque vous aviez l’âge de vos protagonistes, vous aviez vous aussi passé des castings pour devenir mannequin. Est-ce ce souvenir qui est à l’origine de votre envie de raconter l’histoire de Toxic ?
Pas du tout. Les gens me demandent souvent s’il s’agit d’un film autobiographique et j’ai arrêté de mentionner l’anecdote dont vous parlez. On ne cessait pas de m’en faire mention et c’est comme si le film n’était plus vu que sous cet angle-là. C’est fou à quel point les gens veulent qu’un ou une cinéaste ne parle que de soi-même, ils voudraient que chaque film dise « Ceci est ma propre histoire », que ce soit une autobiographie mot pour mot. Il est vrai que je me suis rendue à de tels castings, et peut-être qu’en effet j’avais le vague désir de devenir mannequin mais il faut se rappeler que c’était vraiment dans l’air du temps à l’époque, surtout dans les pays baltes. Dès la cinquième ou la quatrième, il était très fréquent que des gens viennent spécifiquement de l’étranger pour chercher des jeunes filles.
Il arrivait fréquemment que nos cours soient interrompus par de tels castings sauvages, avec un chasseur de tête qui demande soudain à certaines filles de se lever devant tout le monde pour ensuite les inviter à passer à leur agence. Il était fréquent que les filles se rendent entre amies à ces agences, cela ne voulait pas forcément dire qu’elles rêvaient toutes de ce métier, parfois c’était tout simplement un moyen de passer le temps un après-midi. A cet âge-là j’étais grande et mince donc ça suffisait automatiquement à être repérée mais mon envie n’allait pas plus loin. Dès mes quinze ou seize ans j’ai senti une force créative en moi. Je me suis mise à écrire, à faire de la photo. Aujourd’hui j’ai suffisamment de recul pour porter un autre regard sur tout cela.
Le véritable point de départ du film n’était pas la question du mannequinat, c’était des images mentales que j’avais de filles ayant cet âge très particulier que sont les treize ans. C’est très ambigu d’avoir treize ans. Selon les vêtements que l’on choisit de porter, selon le maquillage, on peut avoir l’air d’une gamine de dix ans ou bien d’une jeune adulte de dix-huit ans. C’est cette fluidité qui m’intéressait par-dessus tout. Je me suis entretenue avec beaucoup de femmes autour de cette question, j’ai pris beaucoup de notes et je me suis directement inspirée de certaines situations. C’est d’ailleurs un retour que l’on me fait régulièrement : les gens sentent que certaines scènes doivent être inspirées d’histoires vraies parce que j’y place des détails très spécifiques. J’ai délibérément demandé beaucoup de détails dans les histoires qu’on me racontait afin justement de les retranscrire à l’écran et de rendre les scènes particulièrement crédibles. Treize ans c’est un âge où on vous propose de faire du mannequinat mais c’est bien trop tôt pour commencer à prendre un travail au sérieux et à réfléchir en termes de carrière. C’est vraiment le capitalisme qui veut nous mettre dans le crâne que ces situations sont normales.

Face aux jeunes héroïnes, les personnages adultes ont l’air tout aussi perdus, ils ne possèdent pas davantage de réponses qu’elles. Comment avez-vous envisagé cet aspect de l’écriture ?
Ce n’est pas une idée que j’avais spécialement en tête dès le départ, mais c’est effectivement tombé comme ça. Dans le film, les parents sont aussi un peu des adolescents. Je ne crois pas à cette idée que quand on grandit on comprend soudainement comment le monde fonctionne. Si les héroïnes ne peuvent pas se faire aider par les adultes, c’est avant tout parce qu’ils sont aussi paumés qu’elles. Je tenais à cette absence de hiérarchie entre eux.
Vous filmez beaucoup de décors extérieurs tels des usines désaffectées ou des terrains vagues, et pourtant il se dégage de ces scènes en plein air comme un sentiment carcéral de claustrophobie. Comment êtes-vous parvenue à doser ce paradoxe ?
Je n’ai pas l’impression que les personnages soient particulièrement coincés dans ces décors mais je dois bien me rendre à l’évidence : tout le monde me parle de cette sensation d’emprisonnement. Ca doit vouloir dire que c’est mon point de vue qui est biaisé, et non l’inverse. A titre personnel je ne me sens pas du tout coincée dans de tels paysages industriels car je trouve qu’ils possèdent une puissante dimension nostalgique, presque romantique. De plus, ce sont des lieux où beaucoup de jeunes personnes vivent leurs premiers amours en cachette, là où ils peuvent voir davantage de ciel bleu qu’en centre-ville, là où ils peuvent entendre des oiseaux chanter. Mais bon, je réalise bien qu’ils n’ont pas du tout cet effet là sur la majeure partie des spectatrices et spectateurs (rires).
Pensez-vous que le film serait resté le même si vous aviez dû le tourner dans des décors plus traditionnels ?
Cet environnement était gravé dans le projet du film depuis le tout début, il n’y eu aucun moment où j’ignorais où ça allait se passer. Je tenais beaucoup à ce contraste entre des personnages jeunes et les décors d’un monde déjà terminé, déjà mort. Le début de la vie dans un endroit où la vie est déjà finie. Ces décors sont tellement partie intégrante du film que celui-ci serait radicalement différent si je l’avais tourné ailleurs. Mais plus je réfléchis à la question, plus je réalise que le sentiment qu’ont les héroïnes d’être perdues est quelque chose que j’ai beaucoup travaillé à l’écriture. Cela se trouve déjà dans les dialogues et le scénario, donc finalement cela serait sans doute quand même apparu dans un autre décor. Disons que si tout cela se passait dans un décor plus traditionnel, on se poserait davantage la question de l’origine de leur angoisse, alors que là… (rires)

Comment avez-vous travaillé sur les cadrages particuliers avec votre chef opérateur Vytautas Katkus ?
Un grand nombre de nos décisions ont été dictées par le fait que notre budget était minuscule. Nous tournions avec des actrices non-professionnelles et cela nous a fait réaliser que l’on ne pouvait pas se permettre de multiplier les prises. J’ai essayé de ne pas accabler les actrices en leur demandant de retenir des déplacements trop complexes, je voulais qu’elles se sentent libres et qu’elles conservent leur spontanéité. Peu de prises, peu de mouvement pour les actrices et peu de mouvement de caméra, tout ça égale beaucoup de liberté. Mon premier reflexe fut de vouloir filmer les actrices de près, je pensais que ce serait le meilleur moyen de traduire ce que les personnages ressentent. Vytautas est rapidement venu me libérer de cette idée assez convenue en me disant que c’était un reflexe de jeune cinéaste. C’est lui qui a proposé des plans très larges où l’on verrait les personnages de loin. Ca m’a fait peur au début, mais j’ai vite réalisé que les décors transcendaient les émotions. C’était effrayant mais ça a fini par devenir un jeu : chercher l’endroit le plus bizarre et inattendu où placer une caméra de cinéma. Au final, les gros plans ne m’ont pas manqué du tout.
Votre scénario évoque le rapport parfois violent que l’on peut avoir avec son propre corps à l’adolescence, et cela à travers des détails ou une grammaire visuelle qui peuvent parfois évoquer le body horror. Était-ce quelque chose que vous aviez délibérément à l’esprit ?
Je ne me suis jamais concrètement posé la question du genre mais j’avais bien conscience que certaine scènes seraient dégueues, qu’elles risquaient de rendre les gens malades. Je souhaitais justement traduire avec fidélité à quel point ça peut être dégueu d’être ado : autour de soi tout est répugnant et ne suscite que la déception, le dégoût ou la colère. Je ne me suis jamais reconnue dans l’idée que le monde des jeunes filles est fait de douceur, de naïveté et de couleur rose. Non, même quand on est une jeune fille, il y a de la laideur partout et c’était fondamental pour moi que de le rappeler. Il y a des films où la douleur est laissée hors-champ, il me semblait au contraire indispensable d’être honnête et de parler de la violence qu’on doit s’imposer à soi-même pour avoir l’air belle et parfaite. D’où la présence du vers solitaire ou du gros plan lors de la scène de piercing de langue. C’est ma manière de regarder la vérité en face. Avec l’équipe responsable des décors, on a pris beaucoup de soin à rendre la moins appétissante possible toute nourriture visible à l’écran, on a carrément rajouté des mouches (rires).
La chorégraphie inattendue que vous utilisez pour la scène de danse obéit-elle à un même contrepied face aux clichés sur la féminité ?
Merci de l’avoir remarqué parce que c’était complètement le cas, cette chorégraphie était un travail délibéré de sabotage de la féminité. Quand on a commencé à improviser cette scènes, les actrices avaient pour réflexe de danser de façon sexy. Elles avaient, comme beaucoup d’entre nous, comme premier réflexe d’essayer d’avoir l’air jolies aux yeux des autres. Or pour moi ces personnages sont des filles trop bizarres pour cela, c’était important de le rappeler. Je voulais qu’on sente que le sexualité est quelque chose qu’on projette sur elles plutôt qu’un talent inné qu’elles posséderaient par défaut, parce que c’est rarement le cas dans la vraie vie. Toutes les filles ne veulent d’ailleurs pas être vues sous cet angle et rentrer dans cette catégorie-là. Pour cette scène en particulier, je me suis beaucoup inspiré de la Weird Wave grecque parce que cette danse devait être à mes yeux une rébellion bizarre contre l’injonction à être sexy. La question qui sous-tend tout le film c’est la lutte intérieure entre qui on est et comment on voudrait que les autres nous voient. Cette question est une source d’inconfort pour les personnages et je tenais à ce que cela s’exprime à travers leur danse.

Puisque vous mentionnez le cinéma grec, la manière décalée dont vous filmez l’expression corporelle de vos personnages évoque Attenberg d’Athiná-Rachél Tsangári. Était-ce une de vos références ?
Vous avez 100% raison c’était entièrement ma référence. C’est mon chef opérateur qui m’a conseillé de le regarder avant le tournage et quand je l’ai vu j’ai halluciné. Je me suis beaucoup inspirée des scènes où les deux héroïnes marchent de manière insensée le long des murs. Je voulais que la manière dont mes personnages se déplacent évoque une répétition de danse ou de théâtre, comme si elles s’entrainaient à un autre mouvement plus assuré.
Quel est le dernier film que vous avez vu et qui vous ai donné l’impression de voir quelque chose de neuf ?
Je citerais le documentaire Dig! XX que j’ai découvert au Festival de Vilnius. C’est la suite du documentaire Dig! de 2004, qui fait le portrait croisé des groupes Dandy Warhols et Brian Jonestown Massacre. Les deux groupes sont excellents mais l’un s’avère incapable de s’intégrer dans le système tandis que l’autre fait tout pour avoir du succès, et les deux échouent ! Je me suis beaucoup identifiée à cette question fondamentale : quel chemin suivre ne tant qu’artiste ? Doit-on faire uniquement ce qu’on veut ou bien doit on faire notre possible pour être vu et entendu ? Je recommande ce film même si vous ne connaissez pas les groupes.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 7 avril 2025. Un grand merci à Cilia Gonzalez.
| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Facebook et Instagram ! |