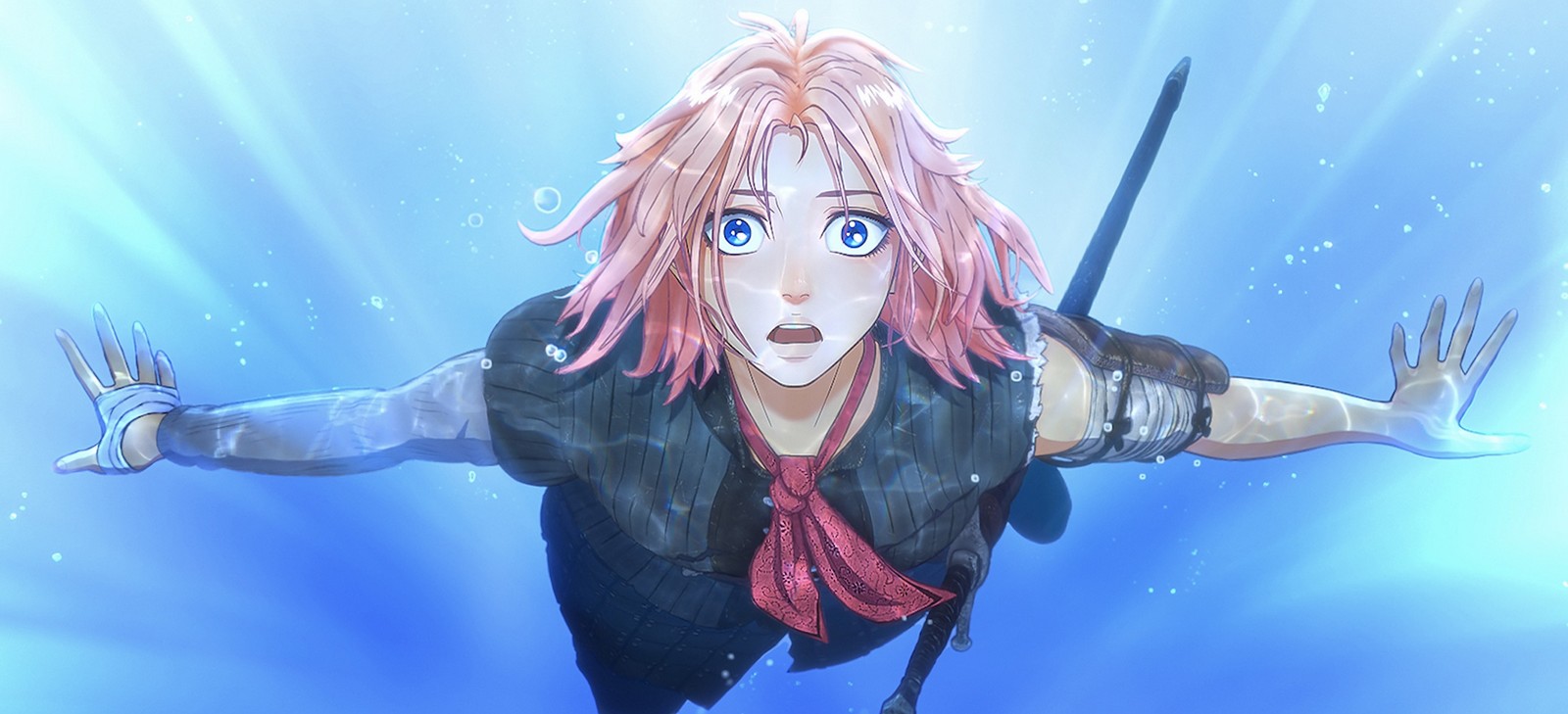C’est une étrange merveille sortie en salles en début d’année et qui est disponible dès maintenant en vod. Premier long métrage de l’Américain Carlo Mirabella-Davis, Swallow raconte l’histoire d’une jeune épouse qui se met à développer un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Ce drame psychologique qui emprunte à l’horreur a été accompagné d’un fort buzz (justifié) durant toute sa tournée en festivals. Carlo Mirabella-Davis est notre invité pour un entretien sans spoiler.
Je voudrais commencer par parler de la toute fin du film, à savoir les images qui accompagnent le générique. Comment avez-vous eu l’idée de ce glissement progressif de l’individu à l’universel ?
Ça a été le fruit d’une longue réflexion entre mes producteurs et moi. J’ai écrit pas mal de versions, et la plupart se sont retrouvées jetées en boule dans ma corbeille. Mon idée de base c’était qu’Hunter devait se retrouver dans un lieu intime et isolé. Or les toilettes sont un lieu qui revient régulièrement dans tout le film, c’est un sanctuaire, un lieu qui procure du réconfort à Hunter. On a passé tout le film à ses cotés et au dernier moment on voit toutes les femmes qui se trouvent avec elle dans ces toilettes publiques. L’idée, c’est que son histoire pourrait être celle de n’importe laquelle de ces femmes. Les thèmes explorés dans Swallow sont universels. On voit toute ces femmes traverser l’écran, on les suit du regard, et ce que l’on est poussé à se demander, c’est à quel point chacune d’entre elles est elle-même victime du patriarcat.

Considérez-vous l’horreur comme un outil narratif permettant de parler des dangers et des peurs qui existent dans un environnement quotidien ?
J’adore l’horreur. On vit nos vies sous la coupe de l’anxiété et la peur. L’horreur a le pouvoir dingue de nous émanciper. Voir l’horreur, c’est presque comme une expérience religieuse : on entre dans un lieu où l’on se sent en sécurité, on voit ce qui nous fait peur projeté sur un écran, on assiste à la manifestation de forces dont on pense qu’elles ont du pouvoir sur nous. Ce que l’on vit à ce moment-là c’est une catharsis, qui nous fait penser qu’on peut vaincre nos peurs, qu’on peut contrecarrer ce pouvoir. J’adore l’horreur subtile de tous les jours, celle que l’on retrouve mêmes dans la moindre interaction humaine. A ce titre, Swallow doit beaucoup à un film comme Under the Skin. On est témoin de l’horreur de la marginalisation d’Hunter, même si son entourage ne le voit pas. Nos sociétés sont pleines de douleurs invisibles, faire un film d’horreur c’est comme braquer un microscope dessus.

Avez-vous un film d’horreur préféré ?
J’en ai plein ! Pour Swallow, j’ai pioché mon inspiration dans Suspiria (l’original) ; les couleurs, l’ambiance, l’originalité, la richesse, l’exploration d’un monde intérieur. J’ai beaucoup repensé aussi à Rosemary’s Baby qui examinait déjà les contraintes du mariage et de la manipulation. J’ai également beaucoup revu Psychose, qui traduit la psychologie des personnages en images, en compositions esthétiques et en décors. L’hôtel est la représentation tangible de la conscience de Bates, sa mère représente l’inconscient qui en demeure prisonnier. J’adore quand le genre met en lumière les douleurs sociales et humaines qui sont habituellement cachées. J’adore aussi The Thing, Get Out et Shining, auquel je reviens toujours.

Comment avez-vous trouvé et travaillé sur les décors, qui ont une vraie fonction narrative dans le récit ?
Je savais que je voulais une maison moderne en verre. On suppose qu’une telle architecture a pour conséquence de nous intégrer dans la nature environnante, mais au contraire, on s’y sent bien trop vulnérable, comme si on était dans un diorama de musée d’histoire naturelle. On sent les yeux de la forêt sur soi. J’ai rapidement trouvé la maison de mes rêves, et par la suite Erin Magill, qui s’occupait des décors, a apporté beaucoup d’idées. Tous les meubles devaient avoir l’air légèrement trop gros, comme s’ils étaient prêts à avaler Hunter. Je me suis amusé à tout filmer avec cette idée en tête. Par ailleurs, Haley Bennett elle-même a suggéré que sa garde-robe devait passer de couleurs chaudes à des teintes progressivement plus ternes et grises, comme si la maison la vampirisait. De façon générale, le film commence de façon très stylisée pour devenir de plus en plus réaliste pour suivre le parcours de Hunter.

Comment avez-vous abordé le traitement visuel du film, très séduisant et coloré, avec votre directrice de la photographie ?
Katelin Arizmendi est une génie de l’image. Elle n’a qu’un très petit nombre de règles, mais cela rend sa maitrise des compositions et des mouvements très spécifique. L’idée c’était qu’au début du film, il devait n’y avoir aucun mouvement de caméra : Hunter est perdue dans le cadre, surtout quand elle se trouve en public. Elle est marginalisée par le cadrage. Puis on brise cette règle à quelques moments-clés, et soudain on utilise un gros plan lorsqu’elle vit une première expérience mystique avec un objet. La maladie de Pica a beaucoup à voir avec la texture des objets, il était donc nécessaire que la photo rende justice à celle-ci, qu’elle soit la plus sensorielle possible.

Hunter est un personnage complexe. Même si elle est naïve, elle n’est jamais dans le cliché de l’héroïne de film d’horreur, à savoir une poupée prête à être sacrifiée. Comment avez-vous écrit ce personnage ?
J’ai toujours été fasciné par les gens qui ont une distance énorme entre leur conscience et leur inconscient.. Hunter porte beaucoup de masques dans le film, et on a eu énormément de chance d’avoir une actrice aussi géniale. Haley est particulièrement douée pour composer un masque de normalité, pour faire des faux sourires qui ont l’air vrais. C’est son premier masque : elle montre ce que les gens veulent voir. Sont deuxième masque : c’est quand elle joue la trahison, et le troisième c’est quand elle révèle enfin son vrai moi. Haley peut donner à voir les trois masques à la fois, d’un seul coup d’œil ou d’une mèche de cheveux. Hunter n’avale pas seulement des objets, elle avale aussi ses émotions, et comme la surface d’un étang, son visage se trouble légèrement quand le refoulé revient à la surface.
Ce qu’a fait Haley sur ce film, c’était un tour de force. Elle s’est tout de suite identifiée à ce que le personnage vivait et disait, elle a entièrement modifié sa voix pour le rôle. Je souhaitais qu’on tourne la toute dernière scène du film en plan-séquence, et elle m’a tout donné dès la première prise, elle avait ça en elle, c’était très émouvant. Haley a non seulement été très impliquée en tant qu’actrice, elle était également très généreuse en tant que productrice. Elle a donné beaucoup de son temps, elle a souvent participé à l’écriture. J’ai eu beaucoup de chance qu’on s’entende si bien, c’était presque télépathique. C’était comme un rêve. D’ailleurs elle utilise beaucoup ses rêves pour nourrir son travail.

Pour finir, j’ai cru lire que, comme nous au Polyester, vous étiez un grand admirateur de John Waters ?
Oh oui c’est mon héros. J’ai non seulement vu ses films mais j’ai aussi lu tous ses livres. J’adore son approche autodidacte de la mise en scène et de l’écriture. J’adore son sens de la provocation, que celle-ci soit sociale ou esthétique. J’adore qu’il se soit créé une communauté d’artistes, une troupe, et qu’il se paye le culot de tourner sans permission. Quand j’avais 19 ans et que j’avais les cheveux verts, je me suis incrusté à la fête de fin de tournage de Pecker. Je suis allé le saluer et lui demander conseil. Il m’a répondu « ne tombez jamais dans le new age ». Je l’ai recroisé plusieurs fois par la suite. Il n’a pas encore vu Swallow, mais j’espère bien qu’il le regardera.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 17 décembre 2019. Un grand merci à Sophie Bataille.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |