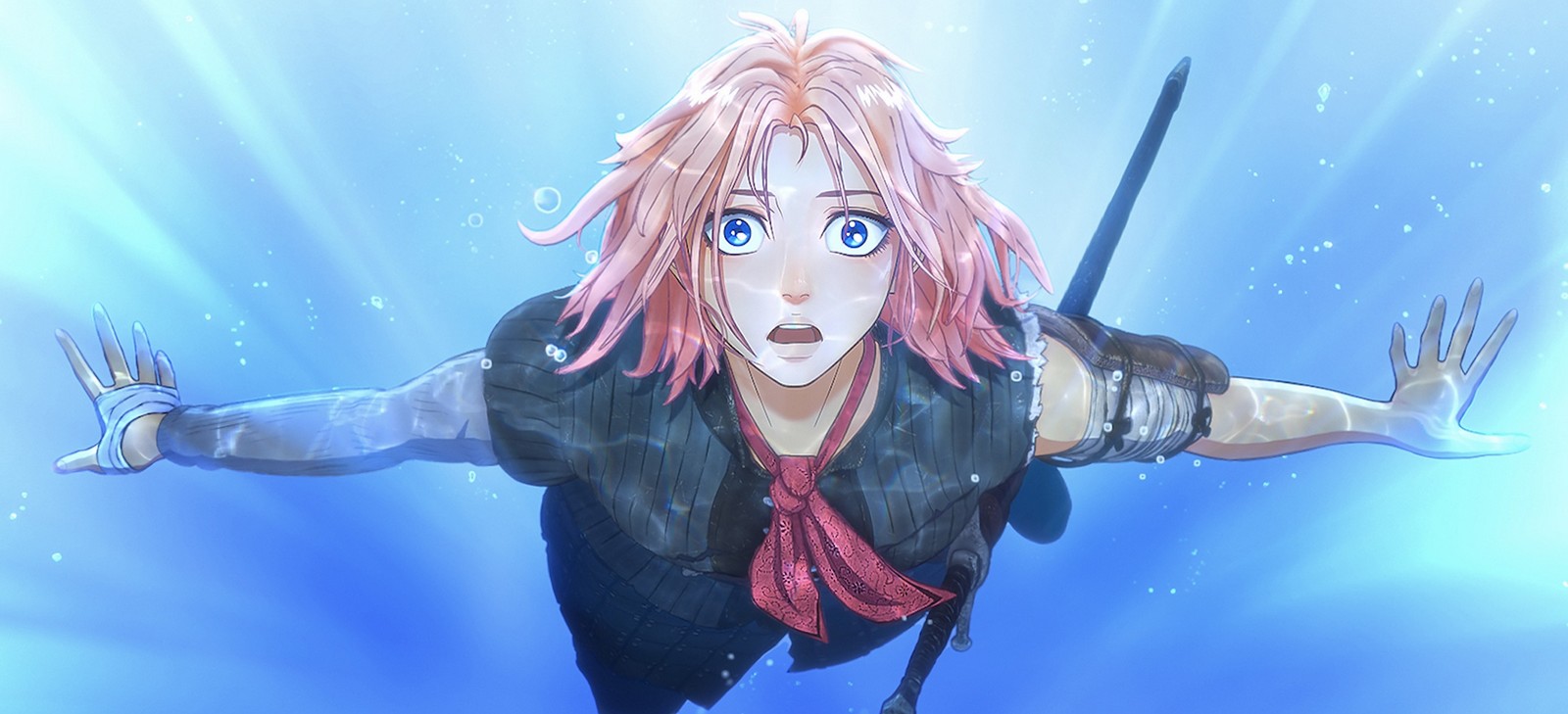Une femme et quatre hommes qui se connaissent à peine se retrouvent dans un appartement en plein ciel au-dessus de Paris. Ils ont tous été la victime du même pervers dominateur qui est enfermé dans une pièce. Ce soir-là, ils ont décidé d’en finir. Tour à tour, ils se racontent des souvenirs qui les lient à cet homme et entrent dans la chambre pour se confronter à lui. Mais ce qui s’y passe entre le monstre et eux reste leur secret.

Haut perchés
France, 2019
De Olivier Ducastel & Jacques Martineau
Durée : 1h30
Sortie : 21/08/2019
Note : ![]()
APRÈS LA RÉPÉTITION
On trouve dans La Bande des quatre une scène-clé de l’œuvre de Jacques Rivette. Afin d’échapper aux menaces d’un pervers manipulateur, les quatre héroïnes du film s’enferment dans leur chambre et se livrent à un jeu curieux. Elles se racontent mutuellement ce qu’elles ont vécu avec cet homme, mais leur récit prend peu à peu la forme d’un jeu de rôle : elles imaginent et improvisent le procès de cet homme, endossant tous les personnages à tour de rôle. L’exercice est ludique, mais il agit comme une formule magique qui vient rompre une malédiction. Avec la seule arme dont elles disposent alors (la parole, ou plutôt la mise en scène de cette dernière), les jeunes femmes trouvent une issue de secours. Elles sortent de leur séance guéries et grandies.
La parole comme instrument enchanteur ? Rétrospectivement, il y avait peut-être déjà cette idée-là en filigrane dans certains films précédents de Ducastel et Martineau, dans les phrases terre-à-terre devenant des mélodies inattendues dans Jeanne et le garçon formidable, ou dans le long dialogue nocturne de Théo et Hugo qui transformait un plan cul en conte de fées. Cette notion est en tout cas davantage flagrante dans Hauts perchés, « pur film de dialogue » (selon les mots des cinéastes) où le verbe et la thérapie vont de pair.
Dans un appartement effectivement haut perché, au point d’être comme coupé du monde (par la nuit alentour, par l’absence de vis-à-vis), quatre hommes et une femme se retrouvent en une étrange réunion secrète. Ils ont tous été amants du même salaud, et sont là pour échanger leurs récits. Les langues fourchent, butent, persiflent aussi, mais se délient. Rendus pathétiques ou agressifs par leurs blessures affectives, ces cinq personnages se retrouvent à ressasser les événements pour mieux les accepter, à répéter les phrases sentimentales ou cruelles pour mieux les tolérer. Ils rejouent en privé leur histoire d’amour pour mieux la maitriser. Ils mettent en scène leur parole pour mieux qu’elle les délivre. Le sale mec en question, caché derrière une porte tel un amant de boulevard, ou tel un authentique squelette dans le placard, pourrait tout aussi bien être absent, ou ne pas exister.
Mis en scène à travers un filtre mélancolique de néons et de synthés, l’appartement en question ressemble à une scène et à un décor de rituel. Celui, magique, de la délivrance, et celui, plus trivial, des aveux faits en cachette comme dans une soirée pyjama d’adolescents. Dans cet échange nocturne, c’est comme si venaient se superposer les voix de différentes générations de cinéastes et dramaturges gay. Outre l’argument qui rappelle celui des Rencontres d’après minuit, on retrouve ça et là la flamboyante perversion de Fassbinder, l’émouvante théâtralité du Vecchiali d’Encore, et bien sûr les confessions entravées et bégayantes de Lagarce. C’est une autre réunion clandestine qui a alors lieu en filigrane : celle d’une histoire parallèle du cinéma.
| Suivez Le Polyester sur Twitter, Facebook et Instagram ! |
par Gregory Coutaut