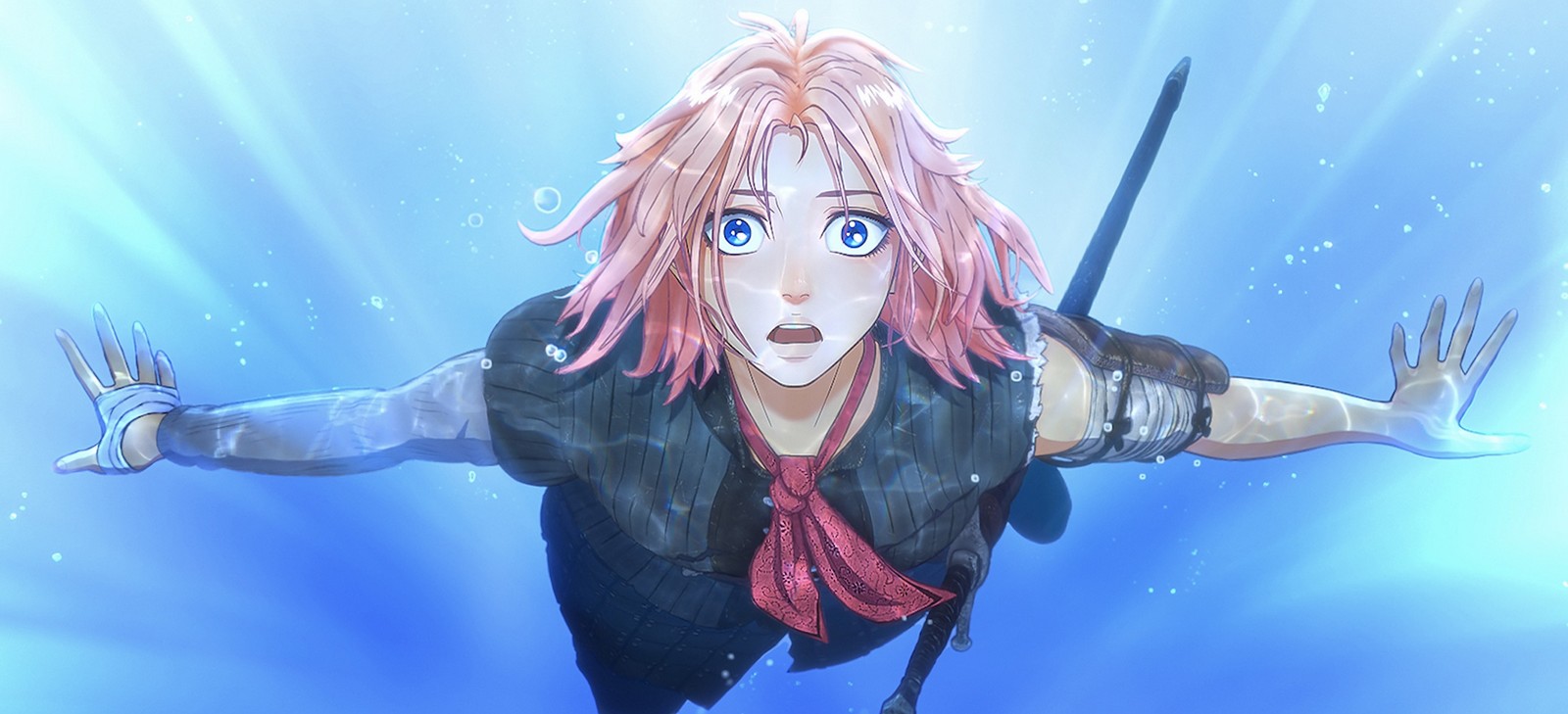Sélectionné coup sur coup au Festival CPH:DOX et à Visions du Réel, Flophouse America est une des découvertes marquantes de ce printemps. La Norvégienne Monica Strømdahl signe le portrait puissant d’une famille pauvre américaine, vivant dans un hôtel bon marché. Elle s’intéresse plus particulièrement au jeune garçon, Mikal et livre un documentaire à la fois honnête et empathique, comme un cousin de Sean Baker mais qui aurait perdu ses couleurs chatoyantes. Ce documentaire poignant et très intime trouve un écho plus large en prenant le pouls d’une Amérique de déclassé•es. Monica Strømdahl est notre invitée.
Quel a été le point de départ de Flophouse America ?
L’origine de Flophouse America remonte en fait à 2005, lorsque j’étais étudiante en photographie à la recherche d’un endroit bon marché pour séjourner à New York. Je me suis retrouvée dans un hôtel à bas prix, qui est devenu un point d’entrée inattendu vers un monde caché, avec des gens qui, bien qu’ils travaillent ou essaient de se remettre sur pied, n’avaient pas de logement stable et n’avaient pas accès au marché locatif traditionnel. J’y suis retournée de nombreuses fois au fil des ans, en vivant au même endroit, photographiant la vie quotidienne et nouant de vraies relations avec les résident•es. Au fil du temps, ce qui a commencé comme un journal visuel de vies oubliées s’est transformé en une exploration à long terme de la crise du logement en Amérique.
C’est lors d’un de ces séjours que j’ai rencontré Mikal, un garçon de 11 ans vif et réfléchi qui grandit au milieu de la pauvreté et de la toxicomanie. Il n’avait jamais vécu ailleurs que dans cet hôtel. Il était jeune, mais éloquent, observateur et étonnamment conscient de la dynamique qui l’entourait. Il est devenu clair pour moi que la photographie ne pouvait pas contenir entièrement son histoire. Je voulais donner à la famille l’espace nécessaire pour raconter sa propre histoire, en lui donnant l’espace de parler, de bouger, de montrer les complexités de sa vie au-delà des images fixes. C’est ainsi que le projet photographique de 15 ans s’est transformé en cinéma.
L’intention a toujours été de présenter Mikal et sa famille non pas comme une statistique, mais comme des êtres humains entiers et complexes. Le film est peut-être ancré dans une seule pièce en Amérique, mais il parle d’un problème mondial. Il y a des millions d’enfants comme Mikal dans le monde, des enfants confrontés à des défis qui se chevauchent comme les traumatismes émotionnels, la pauvreté, la toxicomanie et l’insécurité du logement.
Ce dont ils ont besoin, ce ne sont pas seulement de solutions de fortune, mais de structures cohérentes et bienveillantes, que ce soit par le biais des écoles, des soins de santé, du logement ou des politiques. Avec ce film, j’espère susciter des conversations sur la façon dont nous soutenons les enfants vulnérables, non pas en théorie, mais en pratique.

Comment, concrètement, avez-vous réussi à trouver votre place dans cet espace réduit, et à filmer des scènes aussi intimes ?
La clef, c’était le temps et la confiance. La famille avait une ouverture d’esprit remarquable et une façon de communiquer à laquelle j’ai été invitée. Le défi n’était donc pas l’espace physique, mais l’espace émotionnel que Jason et Tonya me permettaient de partager. La famille voulait que son histoire soit racontée, et je pense que Jason, Tonya et Mikal pensaient qu’il était important que je sois présente. Les limites de l’espace étaient en fait libératrices. Avec moins de choix à faire, j’ai pu vraiment me concentrer et rester ancrée dans le moment présent. J’ai simplement observé et suivi la lumière et les mouvements au fur et à mesure qu’ils se produisaient.
Et Mikal en particulier est un garçon très perspicace et émotionnellement intelligent. Dans une maison où les émotions des adultes dominaient souvent l’espace, la caméra est devenue un moyen pour lui d’en récupérer une partie. Il l’utilisait, en un sens, comme un miroir, pour montrer à ses parents ce qu’il ressentait, ce qu’il vivait. Nous en avons parlé tout au long du processus. Il n’a jamais été passif ; il était très conscient.
Une autre raison pour laquelle cela a été possible est le dialogue étroit que j’ai maintenu avec mes producteurs à la maison. Nous avons eu des appels téléphoniques réguliers tout au long du tournage pour réfléchir à l’éthique de ce que je faisais. Ce soutien et cette perspective ont été incroyablement utiles pour faire des choix réfléchis à l’intérieur de cette petite pièce.

Le chat est très présent tout au long du film. Quel rôle et quelle place vouliez-vous lui donner ?
Smoky, le chat, est le projet commun de la famille, une chose sur laquelle Mikal, Jason et Tonya étaient d’accord et autour de laquelle sont connectées leurs émotions. Il est en quelque sorte devenu un observateur silencieux de l’histoire, tout comme la caméra. Il était souvent le baromètre émotionnel dans la pièce. Ses mouvements créaient de petites ruptures de tension et nous donnaient, en tant que spectatrices et spectateurs, un moment pour respirer. Tantôt il représentait le réconfort, tantôt le malaise. Au cours du processus, il est devenu clair à quel point sa présence était significative dans le monde de Mikal. Cela dit, l’inclusion de Smokey a également aidé dans le processus de montage pour lier les scènes ensemble. Il est donc également devenu d’une grande aide pour faire le film.

Qui sont vos cinéastes de prédilection et/ou qui vous inspirent ?
Je suis inspirée par tout artiste, photographe ou cinéaste qui crée des œuvres avec compassion et empathie. Des photographes et des cinéastes comme Mary Ellen Mark, Jacob Holdt, Anders Petersen, Linda Bournane Engelberth, Line Søndergaard, Simon Lereng Wilmont, Sean Baker, Silje Evensmo Jacobsen, Anton Lindgarden, pour n’en citer que quelques uns. Je suis attirée par les conteuses et conteurs qui n’ont pas peur de la complexité, et qui la montrent avec soin.
Quelle est la dernière fois où vous avez eu le sentiment de voir quelque chose de différent, de découvrir un nouveau talent à l’écran ?
Oh, il y a tellement d’œuvres fantastiques qui sont faites en permanence. Il s’agit à la fois de nouveaux et d’anciens talents, mais je dois mentionner le haut niveau du cinéma norvégien montré dans des films comme Den Siste Våren (Sister, What Grows Where The Land Is Sick, 2022) de Franciska Seifert Eliassen, The Eclipse (2022) de Nataša Urban, et A New Kind of Wilderness (Ukjent Landskap, 2024) de Silje Evensmo Jacobsen. Plus récemment, j’ai eu le plaisir de voir Sanatorium (2024) de Gar O’Rourke, qui vient d’être projeté à Vision du Réel et qui le sera prochainement à HotDocs. Profitez-en !
Entretien réalisé par Nicolas Bardot le 12 avril 2025. Un grand merci à Mirjam Wiekenkamp.
| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Facebook et Instagram ! |