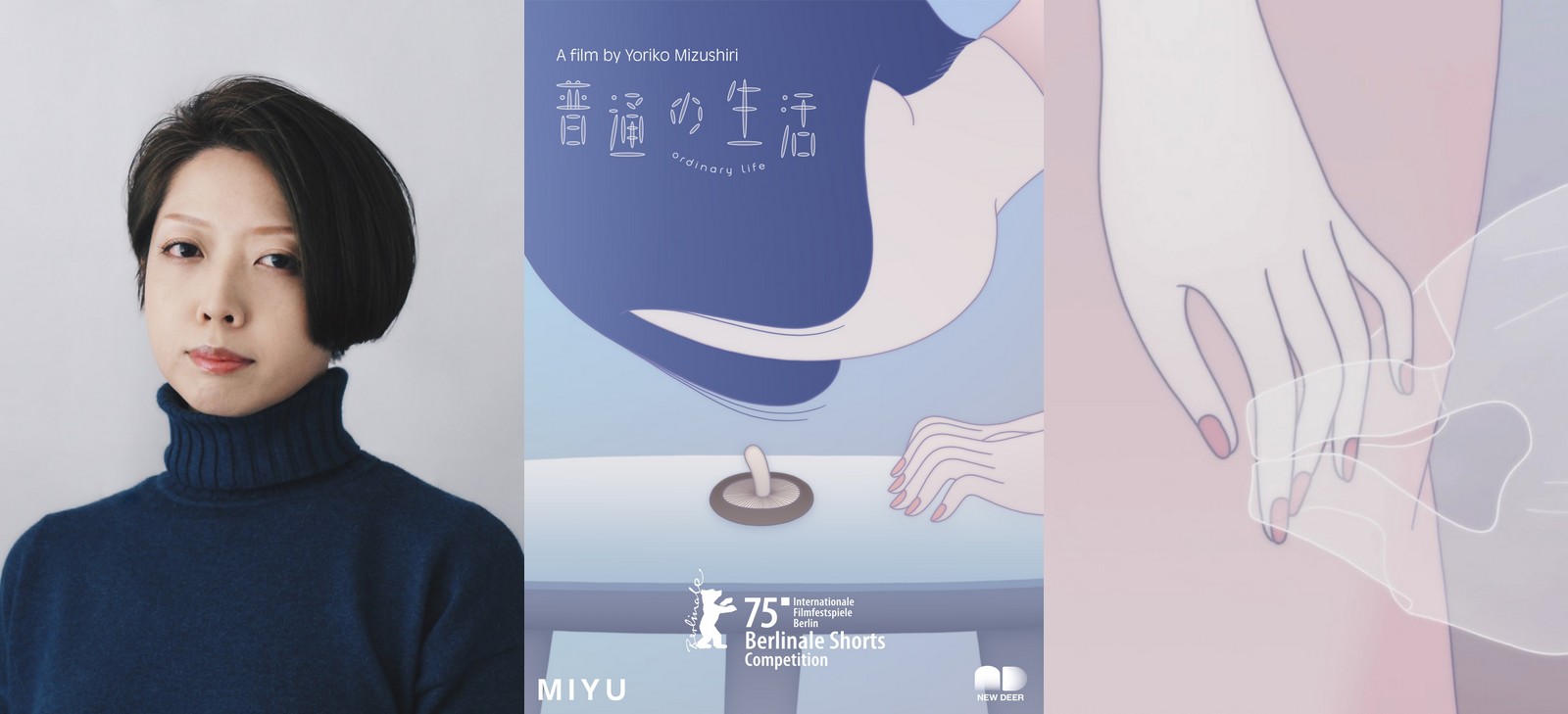Dévoilé dans la compétition du Festival de Rotterdam, Perla est le second long métrage de la Slovaque Alexandra Makarová. Cette production autrichienne raconte l’histoire d’une femme qui vit à Vienne dans les années 80, mais qui va être rattrapée par son passé dans la Tchécoslovaquie communiste. Perla est un drame parano habilement mené, à la reconstitution intelligente et qui sait changer de tonalité avec talent. Alexandra Makarová est notre invitée.
Quelle a été votre source d’inspiration pour ce personnage hors-normes qui donne son titre à votre film ?
L’inspiration m’est venue des femmes de ma famille. Génération après génération, presque toutes ont été des mères célibataires, les hommes étaient absents de leur vie. Elles ont dû lutter. Mes arrières grands-parents ont dû fuir la Russie après la révolution d’Octobre et se sont installées et Tchécoslovaquie. Après la Seconde Guerre mondiale, quand l’Europe a été libérée, les Russes ont pu retrouver la trace de toutes celles et ceux qui avaient fui le pays et c’est comme ça que mon arrière grand-père s’est fait arrêter. Il a fait dix ans de goulag en Sibérie avant d’être libéré. Cette histoire m’a toujours fascinée. Je suis également fascinée par toutes ces femmes de ma famille qui ont dû composer avec ce contexte politique contre lequel elles ne pouvaient rien et qui ont dû élever leurs enfants dans ces conditions.

Quels choix esthétiques avez-vous opérés pour retranscrire à l’image cette époque particulière ?
J’adore faire des recherches. Mon chef opérateur Georg Weiss et moi-même avons donc fait de longues, longues recherches. On a passé trois ans à regarder des films de ou sur cette époque là et à échanger nos points de vue. Après tout, ni lui ni moi n’étions vivant pendant les années 80. Et puis les années 80 étaient très différentes en Tchécoslovaquie par rapport au reste de l’Europe ou aux États-Unis. Nous avons notamment regardé beaucoup de documentaires de la cinéaste autrichienne Elizabeth T. Spira, qui se déroulent certes dans les années 90 mais dans lesquels on sent que rien n’a trop changé depuis les 80’s.
En ce qui concerne la photo et la palette de couleurs, je me suis surtout inspirée de films des années 50 et 60, où la couleur rouge est très présente dans les scènes d’intérieurs. Nous avons donc fait en sorte d’avoir au moins un peu de rouge dans chacune de nos scènes. Avec la costumière Monika Buttinger et la directrice artistique Klaudia Kiczak, nous avons beaucoup discuté sur les moyens de retranscrire ce sentiment des 80s en Europe, et nous en sommes venues à la conclusion que cela passerait avant tout par les costumes et les couleurs. Tout ne pouvait pas passer par les décors : quand vous faîtes un film d’époque et que vous voulez filmer beaucoup en extérieur, vous ne pouvez pas vraiment vieillir les décors naturels, d’où l’importance des costumes. Nous tenions d’ailleurs à ce que les vêtements ne datent pas pile de 1980, parce que dans ce contexte historique les gens devaient garder les vêtements longtemps, ils portaient donc des habits des années 70 ou même 60.

Qu’est-ce qui vous a amenée à privilégier ce format d’image ?
La réponse la plus évidente consisterait à dire que la plupart des films qui se faisaient à l’époque avaient justement ce format mais la vérité c’est surtout qu’il s’agit de mon format préféré, parce qu’il laisse beaucoup d’espace au dessus de la tête des personnages. Par ailleurs, c’est un format très pratique pour un film en costumes puisqu’il permet de ne pas se sentir obligé de remplir toute l’image et d’avoir moins de décor à « vieillir », il y a moins de détails à gérer car c’est étroit.
Cela vous semble-t-il pousser l’interprétation trop loin si l’on dit que Perla peut, par plusieurs aspect, évoquer un film de fantôme ?
Dans quel sens?
Les choix esthétiques dont vous faites mention, associés à ce récit de menace invisible, contribuent à créer une atmosphère qu’on pourrait qualifier de gothique. C’est un mot qui vous semble convenir ?
Oui ça me parle, et je trouve ça très intéressant que vous ayez vu le film sous cet angle. J’aime ça. On sent en effet que quelque chose ne tourne pas rond autour de Perla sans qu’on puisse clairement mettre le doigt dessus. Cela passe beaucoup par la musique bien sûr, nous nous sommes inspiré.es de musiques traditionnelles indiennes à la technique bien particulière, à base de petites percussions placées sur les mains et les doigts et qui créent un rythme très soutenu. On pourrait dire que ce que Perla entend lorsque résonne cette musique c’est son horreur intérieure ou encore le retour des fantômes de son passé. C’est une interprétation avec laquelle je suis d’accord. Quant à la scène avec les parents de Perla, vous avez sans doute compris qu’il s’agit d’un autre type de présence fantomatique.

Ce sentiment d’imprévisibilité angoissante provient aussi de l’étrange rituel rural que vous filmez dans la dernière partie du film. De quoi retourne-t-il exactement dans cette scène ?
Il s’agit d’un vieux rituel slave qui se fait le lundi de Pâques, et qui ne concerne que les femmes célibataires, pas les femmes mariées. Les hommes rentrent dans les maisons de ces femmes et de ces jeunes filles et leur lancent de l’eau à la figure, ou bien ils les attrapent et les jettent de force dans la rivière. Cela, afin qu’elles demeurent fraîches et en bonne santé pour la vie. Mais aussi bien sûr qu’elles restent fertile. Ah oui et une fois le rituel terminé, la tradition veut que les femmes aillent remercier les hommes qui les ont arrosées en leur offrant de l’alcool ou un gâteau qu’elles ont cuisiné elles-mêmes spécifiquement pour l’occasion. Parfois, les hommes peuvent aussi les frapper avec des branches. Bien sûr, si l’on regarde ça d’un point de vue contemporain ça n’a aucun sens, mais il existe encore des gens qui croient dur comme fer qu’il s’agit là d’une question de santé.
C’est un rituel dont j’ai très souvent entendu parler dans ma jeunesse mais comme j’ai grandi en ville, c’était très différent. La seule chose qui me soit arrivée directement c’est que mon grand père me mette de l’eau de Cologne dans le cou dans mon sommeil. Une fois, j’en ai été directement témoin. J’étais adolescente et je me trouvais dans un village près de la frontière ukrainienne. Je me souviens que toute la matinée on entendait les cris des femmes entrecoupés de silence de mort. Cela a fait naitre en moi des sentiments très ambivalents : d’un côté j’étais un peu émoustillée à l’idée que des garçons rentrent dans ma maison, mais de l’autre… Il se trouve que avons tourné cette scène de Perla une semaine avant le lundi de Pâques, et un vieux villageois est venu demander à Rebeka Poláková (l’actrice principale du film, ndlr) : « Alors, excitée pour la semaine prochaine ? ». Quand elle lui a répondu que non bien sûr, et qu’elle ne connaissait aucune femme qui aimait ce rituel, on pouvait voir le choc dans les yeux de cet homme. Il a répondu le plus sérieusement du monde « mais vous tenez tout de même à rester en bonne santé, non ? », on était stupéfaites de réaliser qu’il croyait pour de bon qu’elle allait tomber malade si elle ne se laissait pas faire.
C’est un rituel qui a existé dans plusieurs pays je crois, notamment en Pologne. Je crois qu’à l’origine on se contentait de jeter un épouvantail dans la rivière mais apparemment, les hommes se sont demandé à un moment donné « mais au fait, pourquoi jeter un épouvantail quand on peut jeter une vraie femme ? » (rires).

L’une des surprises du scénario de Perla est la place que vous laissez à la romance dans ce récit de tension. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce parti pris scénaristique ?
Le moment du récit ou Perla retourne enfin dans son village fut le passage que j’ai préfère écrire, j’étais très excitée à l’idée de le tourner. Elle prend à ce moment-là une décision qui lui fait risquer sa vie mais aussi celle de sa fille et de Joseph, tout ça pour passer une nuit avec André. A ce moment-là elle agit avec l’excitation d’une adolescente. Au moment de l’écriture, j’ai beaucoup insisté sur l’ambivalence de Perla en terme de maturité. Après tout il s’agit d’un personnage qui a enfermé son passé à double tour et qui refuse de regarder en arrière. Alors quand elle laisse cette partie-là s’exprimer…
Par exemple j’aime beaucoup la scène du buffet, où elle commande trop à manger. C’est une scène qui a posé problème à beaucoup de personnes, y compris au moment du tournage. Même Rebeka avait des réserves et ne comprenait pas pourquoi le personnage en faisait soudain des caisses, or je voulais précisément que le personnage redevienne une enfant à ce moment-là. Je me suis directement inspirée de moi même : dès que je retourne en Slovaquie je ne peux pas m’empêcher de commander énormément à manger car chaque plat m’apporte un souvenir que je ne peux pas retrouver autrement, chaque plat me raconte l’histoire de ma famille. Je tenais à montrer, parmi toutes les facettes de Perla, cet éclat de folie dont elle est capable par amour et par désir.
Quels sont vos cinéastes de prédilection ou qui vous inspirent le plus ?
Mon cinéaste préféré est Francis Ford Coppola, j’adore Le Parrain, Apocalypse Now et bien sûr Dracula, que j’aime énormément. J’aime aussi beaucoup Antonioni, qui m’a beaucoup inspirée pour Perla. J’ai beau revoir ses films je ne comprends pas comment il parvient à ce mélange de naturel et d’étrangeté. Parmi mes films préférés il y a également Requiem pour un massacre d’Elem Klimov. Et comment pourrais je oublier Wong Kar-wai ? Là encore, son cinéma touche à quelque chose que je ne peux verbaliser. Si vous me demandiez de raconter de quoi parle le scénario d’In the Mood for Love j’en serais incapable car c’est un film fait entièrement de sensations.
Quelle a été la dernière fois que vous avez eu le sentiment de regarder quelque chose de neuf à l’écran ?
Comme beaucoup de personnes j’ai adoré The Substance de Coralie Fargeat. J’ai bien ri mais surtout j’ai trouvé ça très courageux. Après tout, des hommes adultes nus on en voit plein partout mais des corps femmes d’un certain âge, c’est quasiment inédit.
Entretien réalisé par Gregory Coutaut le 3 février 2025. Un grand merci à Barbara Van Lombeek.
| Suivez Le Polyester sur Bluesky, Facebook et Instagram ! |